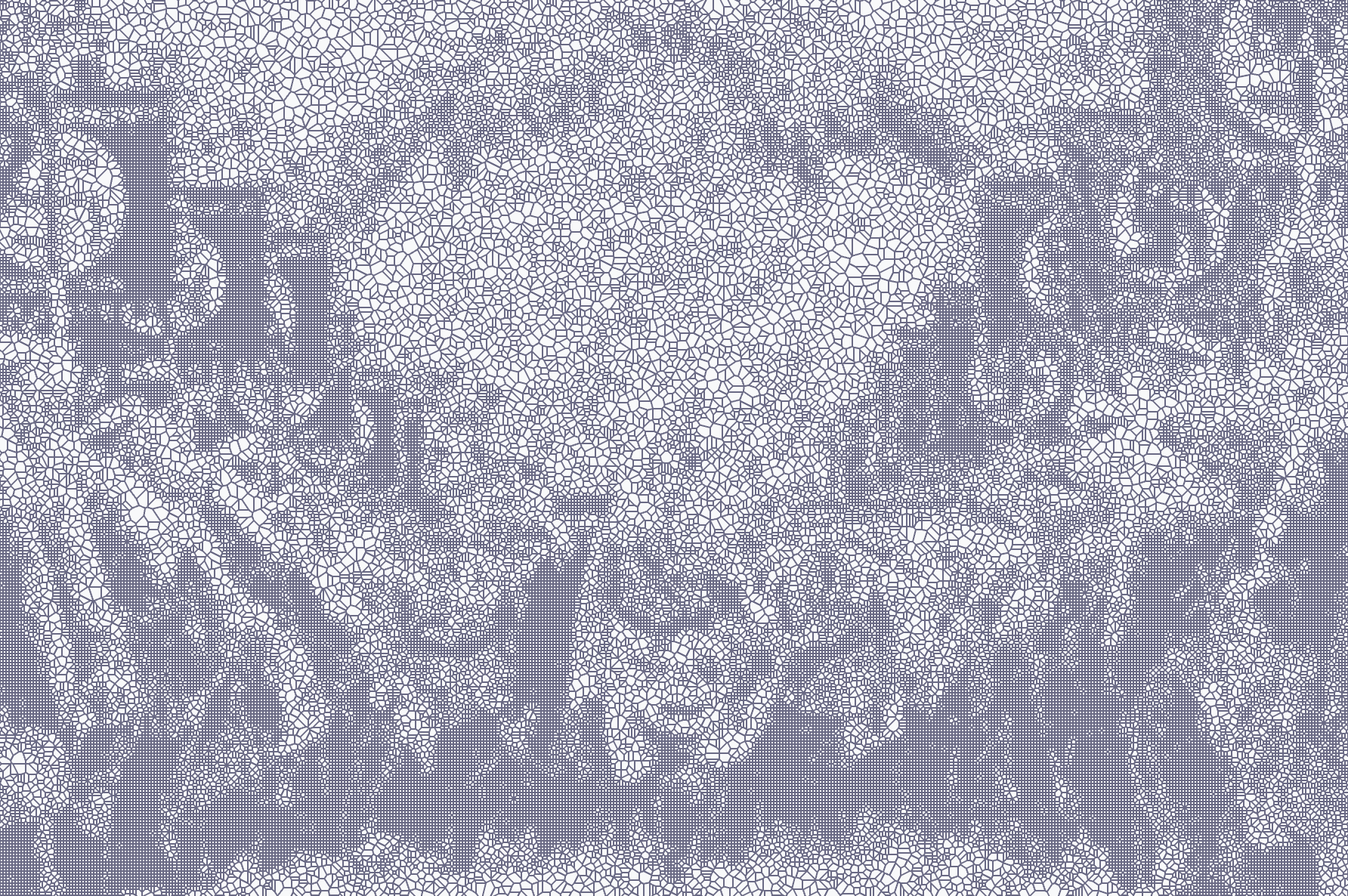Dans la même rubrique
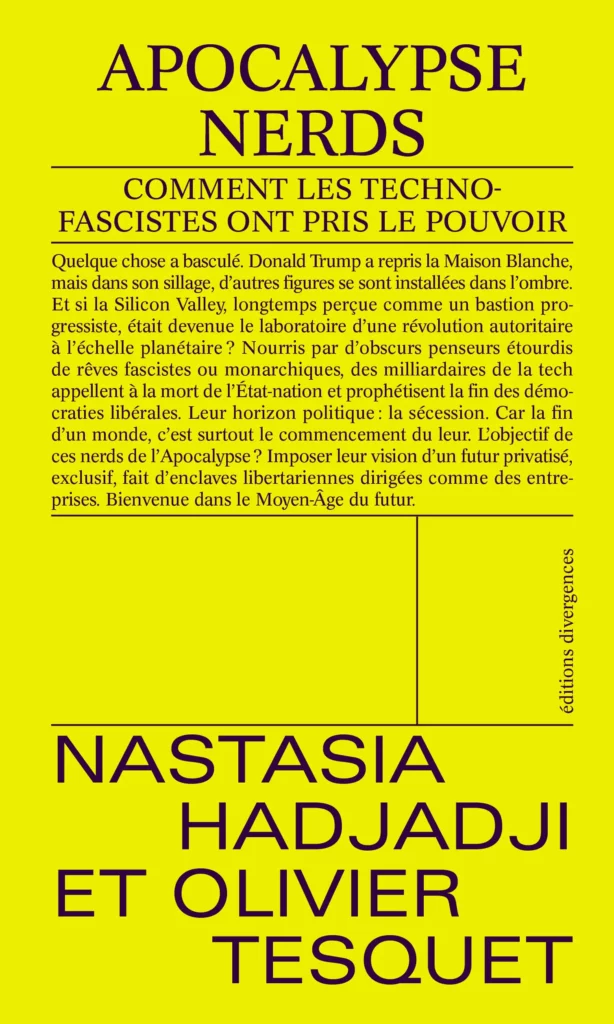
Apocalypse Nerds, Comment les technofascistes ont pris le pouvoir (Divergences, 2025) que publient les journalistes Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet n’est pas sans rappeler le livre du journaliste Thibault Prévost, Les prophètes de l’IA : Pourquoi la Silicon Valley nous vend l’apocalypse (Lux, 2024), paru l’année dernière (voire notre critique). L’un comme l’autre s’interrogent sur la dérive à l’œuvre dans le monde de la tech et sur la recomposition du pouvoir par la technique. L’un comme l’autre interrogent la contre-révolution antidémocratique et ultralibérale qui a cours désormais sous nos yeux. C’est la même histoire qui sature la scène médiatique, celle des Ingénieurs du Chaos qu’explorait avant eux Giuliano da Empoli dans son livre éponyme (JC Lattès, 2019). Tout le monde souhaite comprendre les motivations profondes de l’élite technologique en ramassant les propos confus et contradictoires qu’elle distille. Tout le monde souhaite comprendre la fascination qu’ils exercent et la fascisation qu’ils produisent. Est-ce que la tech conduit au fascisme ? Et si c’est le cas, pourquoi ?
En allant creuser dans les discours souvent alambiqués, fondus ou contradictoires des entrepreneurs et des idéologues de la Tech, ce que montrent surtout Hadjadji et Tesquet c’est que les gens qui ont le pouvoir et la fortune veulent les garder. Leur pseudo rationalisme n’est construit que pour protéger leurs intérêts. Ils ne cherchent qu’à étendre leur pouvoir en démantelant tant l’Etat de droit que l’Etat Providence, celui que nous avons construit collectivement. Ces gens, depuis leurs outils, tentent de mettre le pouvoir à leur service, parce qu’ils se sont rendus compte que leurs outils leur ont donné un incroyable pouvoir et une incroyable richesse. Leur projet séparatiste, à la fois anti-science et anti-démocratique, prône le plus simple populisme : celui d’un retour au chef, à un César auquel nous devrions obéissance, à un capitaine semblable aux capitaines d’industries qu’ils sont, et qui seraient seuls capables de nous guider… Comment expliquer la persistance du mythe du chef, quand on constate combien il s’amenuise partout ? Comment est-on passé d’un « libertarianisme gentiment hostile à l’Etat » à des saluts fascistes ? Comment l’autorité distribuée par les infrastructures techniques des technologies numériques a-t-elle inspiré un tel fantasme de force où l’autorité réelle « modulaire, distribuée, post-idéologique » pourrait à son tour s’auto-administrer ?
Dans le technofascisme, le fantasme ségrégationniste des totalitarismes du XXe siècle reste entier. Les nouveaux nazis n’ont plus d’uniformes militaires et de mitraillettes à leurs ceintures. Ils portent des costumes d’hommes d’affaires, mais leur vision politique est la même : elle consiste d’abord et avant tout à déshumaniser certaines populations. Toujours les mêmes : les étrangers, les pauvres, ceux qui n’ont pas la bonne couleur de peau, les femmes, ceux qui ne pensent pas comme il faut… « En quoi la technologie recompose-t-elle le fascisme ? », interrogent très pertinemment Hadjadji et Tesquet. Certainement en l’habillant d’une allure acceptable, celle d’un fascisme Cool… qui n’en serait pas vraiment un, puisqu’il ne serait que le fascisme de votre patron.
La Tech a toujours été à droite
Derrière le rêve d’une Silicon Valley hippie, démocrate, ouverte, horizontale… que nous avait chanté Fred Turner dans Aux sources de l’utopie numérique (C&F éditions, 2012), la réalité, c’est que ses entreprises ont toujours été des « machines ordonnées à la rigueur quasi-militaire ». Dans la tech, le management a toujours été autoritaire, conservateur. Même en Californie, les syndicats ont toujours été refoulés, la politique d’épuisement des salariés la norme. La hiérarchie et le contrôle sont pour ces gens là le moteur de l’efficacité, quand ils ne sont que la marque de l’autorité de leur pouvoir.
Est-ce ce modèle qui a fini par imposer l’idée que la démocratie est un frein à l’innovation ? Peut-être. Encore faut-il rappeler que le modèle hiérarchique de l’entreprise n’est pas propre à la Silicon Valley, mais s’inscrit dans une tradition bien plus longue liée à l’industrialisation et au pouvoir politique. Dans Temporaire, comment Manpower et McKinsey ont inventé le travail précaire (les arènes, 2021), l’historien du capitalisme, Louis Hyman, rappelle que le modèle d’organisation hiérarchique est né avec l’industrialisation et s’est accompli à mesure que celle-ci s’est diffusée, par exemple chez Ford ou General Motors. Cette organisation de l’industrie n’est pas que le résultat des travaux de Taylor sur l’optimisation de la chaîne de production, mais également ceux d’autres ingénieurs, comme Alfred Sloan qui impose les pratiques comptables, la division en entités et le contrôle des finances, et ce dès les années 20, pour imposer la rentabilité et la segmentation du marché et pas seulement la baisse des coûts de production. C’est aussi l’époque où James McKinsey impose l’analyse des comptes, et où Marvin Bower, qui lui succédera, invente le conseil pour ne pas simplement couper les dépenses, mais trouver les segments de marchés pour faire croître les entreprises. Quant à la redistribution en salaires plutôt généreux, Hyman explique qu’elle est d’abord un levier pour apaiser les revendications syndicales des ouvriers spécialisés et notamment contenir le radicalisme ouvrier : leur faire renoncer à leur demande de contrôle des lieux de travail au profit d’avantages sociaux. Les bons salaires de la tech permettent toujours d’acheter l’obéissance. Et les startups sont plus à considérer comme des véhicules financiers que comme des formes d’entreprises différentes des modèles inventés au XXe siècle. Dans les entreprises, de la Valley comme ailleurs, la démocratie est toujours restée limitée, non pas parce qu’elle serait un frein à l’innovation, mais bien parce qu’elle est toujours considérée comme le frein à l’enrichissement du capital sur le travail.

C’est le même constat que dresse d’ailleurs l’historienne Sylvie Laurent dans le lumineux petit libelle, La Contre-révolution californienne (Seuil, 2025), qui remet en perspective l’histoire techno-réactionnaire de la Californie. Pour elle, la fascisation de Musk, les projets antidémocratiques de Thiel, la masculinisation de Zuckerberg ou les compromissions de Bezos, nous ont fait croire à un virage à droite de quelques milliardaires excentriques, mais a invisibilisé les véritables orientations politiques de la Tech. Laurent rappelle que l’industrie californienne a toujours été bien plus Républicaine et conservatrice que progressiste. Mieux, elle montre que la révolution numérique a bien plus épousé la révolution néolibérale reaganienne et le réenchantement de la société de marché que le contraire. Elle pointe « la dimension éminemment raciale » de la défense absolue de la propriété et de la haine des régulations et interventions fédérales. Bref, que le « futurisme réactionnaire » des années 80 va s’appuyer sur le prophétisme technologique et sa promesse de renouveau de la croissance économique. C’est dès cette époque que les industries de hautes technologies sont gratifiées d’exemptions fiscales pour faciliter leur déploiement, de contrats fusionnels avec l’armée et l’Etat pour promouvoir une rationalisation des choix publics. « Parce qu’elle contient le mot de liberté, l’idéologie libertarienne semble indépendante de toute tradition politique, voire paraît émancipatrice. Mais ses affinités électives avec l’extrême droite depuis un demi-siècle doivent se comprendre à la lumière du soleil californien : la haine libertarienne de l’Etat, c’est la haine de l’égalité ». Pour ces grands patrons, la liberté ne désigne que le capitalisme et son principe d’accumulation. La glorification du plus éminent symbole de son succès, la figure de l’entrepreneur, finit par nous faire croire que l’autoritarisme oligarchique est le remède dont la société aurait besoin. « L’instance honnie n’est pas l’Etat comme abstraction, mais l’Etat libéral et démocratique qui prétend défaire les hiérarchies naturelles ». Pour Sylvie Laurent, la Silicon Valley ouvre un espace de transformation sociale de croissance économique par la dérégularisation. La Tech sera très tôt bien plus l’artisan d’une sous-traitance zélée à surveiller et à réprimer qu’à libérer les individus, via une collusion grandissante avec l’Etat. Pour Sylvie Laurent, la Californie n’est pas le lupanar des hippies, mais celui des réacs qui y ont construit leurs outils de réaction.
Pas étonnant donc que pour des gens comme Thiel, la liberté de marché et la démocratie soient incompatibles. La technologie s’impose alors comme une alternative à la politique, à l’image de Paypal, imaginé comme un moyen technique pour renverser le système monétaire mondial. Thiel a toujours vu ses investissements comme un moyen pour promouvoir ses idées, contourner les régulations, imposer ses valeurs. Avec Palantir ou Clearview, il finance des outils qui visent ouvertement à déstabiliser l’Etat de droit et imposer leur seule domination.
Le rapport de force comme méthode, le culte du chef comme idéal
Hadjadji et Tesquet rappellent très pertinemment, que si les idéaux de la Valley semblent se concaténer autour d’un petit groupe d’idées rances, l’idéologie, autre que le libéralisme débridé, semble peu présente. Le trumpisme ne repose sur aucun manifeste. Il n’est qu’un « répertoire d’actions », dont le pouvoir se résume à la pratique du deal (The art of deal était d’ailleurs le titre de l’autobiographie de Trump, où il égraine ses conseils pour faire du business et prône non pas tant la négociation, que le rapport de force permanent). Les deux journalistes rappellent, à la suite du philosophe allemand Franz Neumann, que le nazisme n’était également rien d’autre qu’un champ de bataille entre factions concurrentes. La désorganisation tient bien d’une polycratie où s’affronte différents courants au gré des loyautés personnelles. Il n’y a pas de programme unifié, seulement un langage politique commun qui puise dans un syncrétisme instable et complexe, qu’Emile Torres et Timnit Gebru on désigné sous le nom de Tescreal. Sous couvert d’innombrables courants idéologiques confus, racistes, eugéniques, libertariens, transhumains… se rassemblent des gens qui pensent que la démocratie ne fonctionne plus et que la technologie est plus fiable que les institutions humaines, que le rationalisme permet de soumettre la morale à la logique, enfin surtout à la leur. Au-delà de leurs divergences, ces gens pensent que la fin justifie les moyens et que la hiérarchie permet d’organiser le monde et leur autorité.
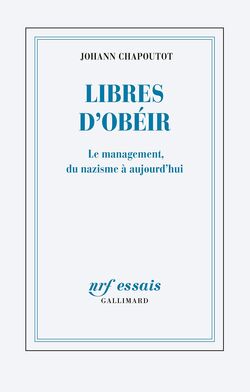
Pour ces gens, le chef d’entreprise reste celui qui prend les décisions en dernier recours, notamment en temps de crise. Le mythe de l’entrepreneur est venu se confondre avec le mythe du chef providentiel. D’abord parce que l’un comme l’autre permettent d’affirmer un pouvoir sans démocratie. Le mythe du capitaine d’industrie est né avec l’industrialisation, pour pallier à l’érosion de l’Etat absolutiste et pour lutter contre les théories démocratiques et socialistes. Il a notamment été théorisé par les premières organisations patronales, comme le Comité des forges. Dans l’entre deux guerres, les mêmes vont mobiliser les premières théories managériales pour promouvoir la hiérarchie, non sans lien avec la montée de l’extrême droite, comme le montre l’historien Johann Chapoutot dans ses livres Libres d’obéir : Le Management, du nazisme à aujourd’hui (Gallimard, 2020) et Les Irresponsables : Qui a porté Hitler au pouvoir ? (Gallimard, 2025). Comme l’explique l’historien Yves Cohen, notamment dans son livre, Le siècle des chefs (Amsterdam, 2013), la formation d’un discours qui étaye de nouvelles pratiques de commandement se construit entre 1880 et 1940 dans des domaines aussi variés que la politique, l’armée, l’éducation ou l’entreprise. La figure du chef est une réponse « à l’irruption de phénomènes de masse inconnus jusqu’alors » et qui se propose de remplacer l’aristocratie dévalorisée par l’histoire, par ceux qui dominent l’économie. Elle cherche à mêler la force des systèmes industriels qui se construisent, la force des structures capitalistes, à leur incarnation, en personnalisant la rationalité des structures d’hommes providentiels. Le culte du chef est profondément lié au développement du capitalisme.
Ce culte du chef et de la décision comme rapport de force est également au cœur de la technologie numérique, rappellent les journalistes. C’est le principe notamment des interfaces de programmation (API), « un protocole qui permet à une fonction d’être réutilisée ailleurs, sans que le programmeur ait besoin d’en comprendre tout le fonctionnement interne ». Il suffit d’appliquer la recette. L’API rend les idées portables, interopérables, mais plus encore fonctionnelles partout où l’on peut les utiliser. Dans le numérique, les décisions se répercutent en cascades obéissantes. Les possibilités sont des fonctions circonscrites. Les décisions s’imposent partout et se déploient via les protocoles dans tous les systèmes interconnectés. Les logiques de classement, de tris, d’ordres se distribuent partout, d’un clic, sans discussion. Le rapport de force est tout entier dans la main de celui qui contrôle le système.
Pour Musk et ses sbires, tous de jeunes informaticiens, prendre le contrôle de l’État, c’est d’abord prendre le contrôle informatique de l’État. Alors qu’internet était censé nous libérer des autorités, la sacralisation des règles, des scripts, des modes d’organisation toujours plus strictes car organisés par la technologie numérique, nous a conduit à sacraliser l’autorité, expliquions-nous il y a longtemps. Le contrôle, la séparation des tâches, les règles, les processus ont envahi les organisations et semblent être devenus les nouvelles formes d’autorités. L’autorité permet de simplifier la complexité, disions-nous, c’est en cela qu’elle l’emporte. Avec elle, une forme de management antisocial se répand. Le numérique a fait la démonstration de son pouvoir. Il a montré que le logiciel était là où le rapport de force s’exerçait, s’appliquait. La technologie recompose le pouvoir à son avantage et le distribue en le rendant fonctionnel partout.
Le pouvoir est un script
« Au putsch et à son imagerie militaire, les technofascistes préfèrent le coup d’Etat graduel, une sorte d’administration du basculement, sans recours à la force ». C’est le soft coup qui vise moins à infiltrer le pouvoir qu’à paralyser les institutions démocratiques pour les décrédibiliser. Le but premier, c’est l’épuration, la chasse aux sorcières, pour mettre en place une organisation discrétionnaire. C’est l’épuration des progressistes et de leurs idées. Le dégagisme. C’est le programme qu’applique le Doge : virer les fonctionnaires, rationaliser les dépenses – enfin, uniquement celles liées aux idées progressistes. Le but, produire un État minimal où le marché (et la police) régira les interactions. Ultralibéralisme et autoritarisme s’encouragent et finissent par se confondre.
Pour les deux journalistes, « on assiste à l’émergence d’un pouvoir césariste, plébiscité non pour sa légalité mais pour sa capacité à se montrer brutal ». Le CEO vient prendre possession d’un système, pour le subvertir sans le renverser. Pourtant, « le pouvoir ne se situe plus tant dans l’autorité d’un individu, que dans l’activation d’un système ». La souveraineté tient désormais d’une API, elle est un service qui se distribue via des plateformes privées. Le pouvoir est un script, une séquence d’instructions, qui se déploie instantanément, qui s’instancie, comme un programme informatique. Le monde n’a plus besoin d’être gouverné politiquement, il est seulement organisé, configuré par les outils technoscientifiques qui ordonnent la société. Pour cela, il suffit de réduire la réalité à des algorithmes, à des variables qu’il suffira d’ajuster, comme les programmes des cabinets de conseils comme McKinsey, Accenture, Cap Gemini, PWC… qui déploient leurs logiciels sur les systèmes sociaux, d’un pays l’autre. Dans le technofascisme, « le pouvoir devient une simple interface de gestion de l’ordre ». « C’est un système sans procédure de recours, qui proclame son affranchissement du droit ». Ce modèle n’est pas une idéologie, mais une méthode, un template, disent très justement les deux journalistes. « L’Europe réactionnaire ne s’unifie pas par le haut » (c’est-à-dire par les idées), « mais s’agrège par le bas, par mimétisme fonctionnel. Ce ne sont pas des idées qui circulent, mais des scripts. Une grammaire d’action ». La politique est désormais une question d’ingénierie, mais seulement parce qu’elle ne promeut qu’une grammaire : une grammaire ultralibérale et ultra-autoritaire dont la seule langue est de produire de l’argent.
Pour beaucoup qui vénèrent l’efficacité des méthodes de la Tech, qui croient en l’incarnation de son pouvoir dans ces grands hommes providentiels, le technofascisme n’est pas un fascisme. Il ne serait qu’un capitalisme sans plus aucune contrainte dont les effets de bords ne seraient que des dommages collatéraux à l’égard de ceux qui ne sont rien.
L’illusion de la sécession, le rêve de l’impunité…
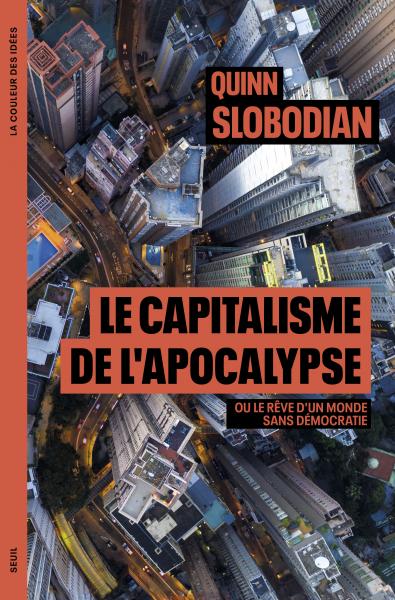
Le modèle qu’ils proposent, c’est celui de la zone économique spéciale, que décrit l’historien du néolibéralisme Quinn Slobodian dans Le capitalisme de l’apocalypse (Seuil, 2025). Celles des enclaves autoritaires de Dubaï, Singapour ou Hong-Kong. Celles des paradis fiscaux et des zones d’accélération technologiques, comme Shenzhen. Celles de territoires qui ne sont pas des nations car sans démocratie. Derrière le rêve de sécession, le modèle est celui de l’accaparement, disent Naomi Klein et Astra Taylor. Mais cet imaginaire sécessionnistes prend l’eau, rappellent les journalistes en racontant les échecs des projets de micro Etats bunkers, comme Praxis (un délire dans lequel les mêmes ont encore investis), XLII d’Ocean Builders (des structures flottantes qui se veulent des villes libres et qui tournèrent au fiasco, ses promoteurs regagnant bien vite la protection de leur pays d’origine pour éviter la prison : la citoyenneté occidentale a encore bien des atouts !) ou encore Prospera au Honduras (l’enclave libertarienne a fini par être déclarée anticonstitutionnelle). Ces tentatives de néoconquistadors se sont surtout soldées par des échecs. Elles montrent surtout que ces gens n’ont pas dépassé le stade du colonialisme. Ils rêvent de bunkers, de communautés fermées. Derrière Starbase, la ville dont le maire est un PDG, se profile le vieux rêve de Sun City, la ville censitaire pour riches vieillards. Au mieux, ces citoyennetés se terminent en hôtels de luxe pour digital nomads. La sécession est bien loin. La citoyenneté ne nécessite plus d’impôts, seulement un abonnement. A se demander ce que cela change ?! Hormis mieux exclure ceux qui ne peuvent se le payer. Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet ont bien raison de pointer que cette pensée magique et facile est « saturée d’angles morts ». Que signifie le monde censitaire qu’ils dessinent, hormis une puissance et des droits selon le niveau de fortune ? Ce que les gens doivent comprendre, c’est que dans un tel monde, les droits des milliardaires seraient sans commune mesure par rapport aux droits des millionnaires… Même la police, censée encore assurer l’ordre (bien qu’on pourrait la remplacer par des robots) serait ici une sous-classe sans droits. Le monde qu’ils proposent n’est pas fonctionnel.
La grande tâche des libertariens n’est pourtant pas tant d’échapper à la politique que d’imposer la leur par la force. D’imposer une impunité à leur profit que leur seule richesse ne leur accorde pas. Leur seule volonté est de précipiter la chute du système démocratique. Ceux qui détestent la démocratie ne cessent de continuer à trouver tous les moyens pour nous en convaincre, dans le seul but qu’on leur rende le pouvoir, nous disait déjà le philosophe Jacques Rancière.
Ce à quoi le livre ne répond pas c’est pourquoi les gens sont si séduits par ces discours. La simplicité, certes. Le fait de trouver des boucs-émissaires certes. Quelque chose d’autre fascine me semble-t-il. Le désir d’autorité d’abord, quand bien même chacun est capable de se rendre compte que s’il désire la restauration de la sienne à l’égard des autres, nul ne supporte celle des autres – et surtout pas ceux qui n’ont que ce mot là à la bouche.
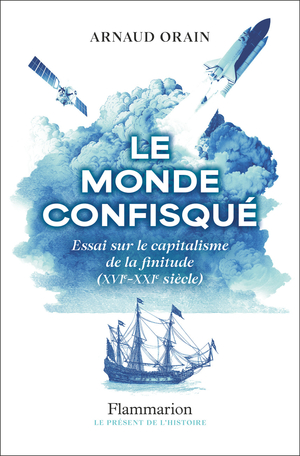
La croyance que chacun peut devenir l’un de ceux-ci, ensuite. Oubliant qu’en fait, c’est absolument impossible… L’essor des technologies numériques a fait croire que chacun pouvait devenir milliardaire depuis son garage. Cela a peut-être été le cas de quelques-uns. Mais c’est devenu une illusion de le croire encore à l’heure où les investissements dans la tech sont devenus faramineux. La Tech a été le dernier bastion du rêve d’enrichissement “généralisé et illimité”, explique l’économiste Arnaud Orain, qui publie Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle) (Flammarion, 2025). A l’heure du capitalisme de la finitude, le rêve de puissance et de richesse reste entier pour beaucoup, oubliant que l’abondance est derrière nous, et que la solidarité et la justice nous proposent des vies bien plus fécondes que le seul argent.
Hubert Guillaud