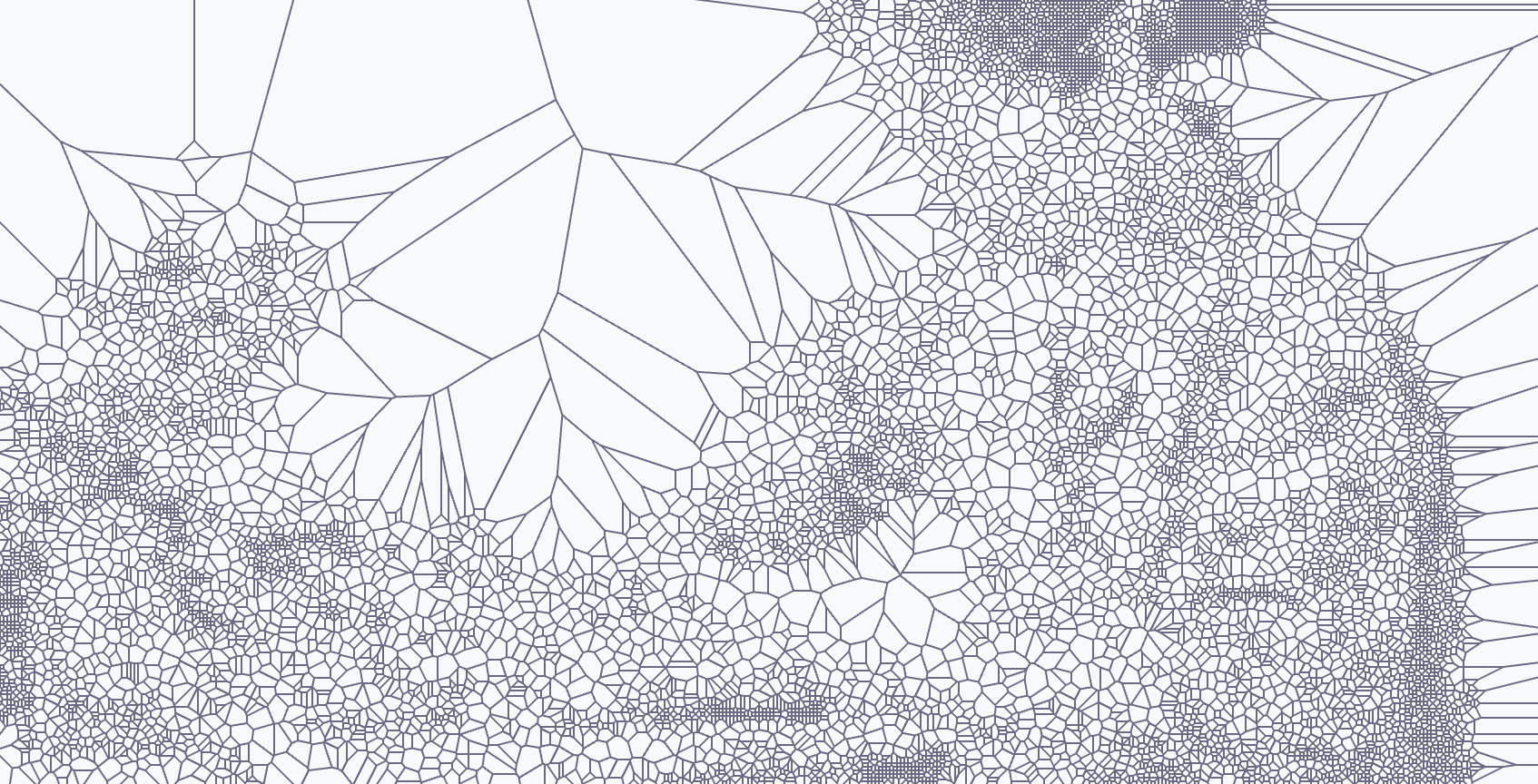Dans la même rubrique
L’IA prédictive comme générative semble offrir une multitude d’avantages à l’élaboration des politiques publiques : de l’analyse de données complexes à l’optimisation des ressources. Elle semble à la fois être capable d’apporter une vision globale et d’identifier les leviers permettant de la modifier. Recourir à l’IA signifie mettre en place des politiques conduites par les données, ce qui permet d’assurer une forme d’objectivité, notamment quant il s’agit de rationner le service public…
Mais, cette production de solutions politiques semble oublier que l’IA est incapable de résoudre les problèmes structurels. Elle propose des solutions performatives qui obscurcissent et amplifient les problèmes, explique l’iconoclaste Dan MacQuillan dans un article pour la Joseph Rowntree Foundation, une association britannique de lutte contre la pauvreté, qui a initié une réflexion sur l’usage de l’IA pour le bien public. Dan McQuillan est maître de conférence au département d’informatique de l’université Goldsmiths de Londres. Il est l’auteur de Resisting AI, an anti-fascist approach to artificial intelligence (Résister à l’IA, une approche anti-fasciste de l’intelligence artificielle, Bristol University Press, 2022, non traduit) dont nous avions déjà parlé.
McQuillan rappelle que l’IA, par principe, consiste à produire des corrélations réductrices plutôt que des analyses causales. « La complexité de l’IA introduit une opacité fondamentale dans le lien entre les données d’entrée et les résultats, rendant impossible de déterminer précisément pourquoi elle a généré un résultat particulier, empêchant ainsi toute voie de recours. Ce phénomène est aggravé dans les applications concrètes, où les résultats apparemment fiables de l’IA peuvent devenir auto-réalisateurs. Un algorithme d’apprentissage automatique qualifiant une famille de « difficile » peut ainsi créer une boucle de rétroaction entre les membres de la famille et les services sociaux. De cette manière, l’IA imite des phénomènes sociologiques bien connus, tels que les stéréotypes et la stigmatisation, mais à grande échelle ». Ses inférences au final renforcent les stratifications sociales de la société comme pour les rendre acceptables.
Or, rappelle le chercheur, « une bonne politique doit impérativement être ancrée dans la réalité ». C’est pourtant bien ce lien que rompent les calculs de l’IA, à l’image des hallucinations. Celles-ci proviennent du fait que l’IA repose sur l’imitation du langage plutôt que sa compréhension. Le même principe s’applique à toutes les prédictions ou classifications que produit l’IA. « Que l’IA soit appliquée directement pour prédire la fraude aux aides sociales ou simplement utilisée par un décideur politique pour « dialoguer » avec une multitude de documents politiques, elle dégrade la fiabilité des résultats ».
Des données probantes suggèrent déjà que l’imbrication des algorithmes dans les solutions politiques conduit à une appréciation arbitraire de l’injustice et de la cruauté. Les scandales abondent, de Robodebt en Australie à l’affaire des allocations familiales aux Pays-Bas, qui auraient tous pu être évités en écoutant la voix des personnes concernées. Mais l’IA introduit une injustice épistémique, où la capacité des individus à connaître leur propre situation est dévaluée par rapport aux abstractions algorithmiques. Si l’IA, comme la bureaucratie, est présentée comme une forme généralisée et orientée vers un objectif de processus rationnel, elle engendre en réalité de l’inconscience : l’incapacité à critiquer les instructions, le manque de réflexion sur les conséquences et l’adhésion à la croyance que l’ordre est correctement appliqué. Pire encore, l’IA dite générative offre la capacité supplémentaire de simuler une large consultation, que ce soit par « l’interprétation » hallucinatoire d’un grand nombre de soumissions publiques ou par la simulation littérale d’un public virtuel et prétendument plus diversifié en remplaçant des personnes réelles par des avatars d’IA générative. Une technique, qui, si elle a l’avantage de réduire les coûts, est dénoncée par des chercheurs comme contraire aux valeurs mêmes de l’enquête et de la recherche, rappelait Scientific American. « L’approche technocratique mise en œuvre par l’IA est à l’opposé d’un mécanisme réactif aux aléas de l’expérience vécue », explique McQuillan. « L’IA n’est jamais responsable, car elle n’est pas responsable ». Si l’on considère les attributs de l’IA dans leur ensemble, son application à l’élaboration des politiques publiques ou comme outil politique aggravera l’injustice sociale, prédit le chercheur. L’apport de l’IA à l’ordre social ne consiste pas à générer des arrangements de pouvoir alternatifs, mais à mettre en place des mécanismes de classification, de hiérarchisation et d’exclusion.
Chaque signalement par l’IA d’un risque de fraude, d’un classement d’une personne dans une catégorie, mobilise une vision du monde qui privilégie des représentations abstraites à la complexité des relations vécues, et ce dans l’intérêt des institutions et non des individus. « Imprégnées des injustices criantes du statu quo, les solutions de l’IA tendent inexorablement vers la nécropolitique, c’est-à-dire vers des formes de prise de décision qui modifient la répartition des chances de vie par des désignations de disponibilité relative. Détourner massivement les individus des parcours éducatifs ou des prestations sociales dont ils ont besoin pour survivre, par exemple, constitue un filtre algorithmique pour déterminer qui est bienvenu dans la société et qui ne l’est pas ».
Le problème, c’est que la pression sur les décideurs politiques à adopter l’IA est immense, non seulement parce que ses biais viennent confirmer les leurs, mais plus encore du fait des engagements commerciaux et des promesses économiques que représente le développement de ce secteur. Et McQuillan de regretter que cette orientation nous éloigne de l’enjeu éthique qui devrait être au cœur des politiques publiques. La politique s’intéresse de moins en moins aux injustices structurelles de la société. « Un monde où l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques reposent sur l’IA est aussi un monde qui confère un pouvoir considérable à la petite poignée d’entreprises capables de disposer de ces ressources ». Par essence, « l’adoption de l’IA constitue un engagement en faveur de l’extractivisme et d’un transfert de contrôle à un niveau qui supplante toute politique réelle ».
En fait, explique McQuillan, adopter l’IA dans l’élaboration des politiques publiques revient à soumettre les politiques à des agendas corporatifs et idéologiques plus vastes (à savoir se soumettre à ceux qui ont déjà décidé que l’avenir de la civilisation réside dans l’intelligence artificielle générale (IAG), ceux qui ont décidé que la meilleure réponse à la crise structurelle est de la masquer sous le battage médiatique de l’IA, et ceux qui ont conclu que le meilleur moyen de maintenir les revenus en période de récession mondiale est de remplacer les travailleurs réels par des émulations d’IA de mauvaise qualité). L’impact net de l’IA dans l’élaboration des politiques la rendrait plus précaire et favoriserait l’externalisation et la privatisation sous couvert d’une technologie surmédiatisée. Il s’agit d’une forme de « stratégie du choc », où le sentiment d’urgence généré par une technologie prétendument transformatrice du monde est utilisé comme une opportunité pour l’emprise des entreprises et pour transformer les systèmes sociaux dans des directions ouvertement autoritaires, sans réflexion ni débat démocratique.
Pour Dan McQuillan, plutôt que de se demander comment l’IA va imprégner l’élaboration des politiques, il faudrait se concentrer sur des politiques publiques qui favorisent la dénumérisation. C’est-à-dire favoriser une stratégie sociotechnique de réduction de la dépendance à l’échelle computationnelle, de participation maximale des communautés concernées et de reconnaissance accrue du fait que le raisonnement computationnel ne saurait se substituer aux questions politiques exigeant un jugement réfléchi et perspicace. L’IA, en tant qu’appareil de calcul, de concepts et d’investissements, est l’apothéose de la « vue d’en haut », l’abstraction désincarnée du savoir privilégié qui empoisonne déjà nombre de formes d’élaboration des politiques. Pour McQuillan, un pivot vers la « décomputation » est une façon de réaffirmer la valeur des connaissances situées et du contexte sur le seul passage à l’échelle. Contrairement aux prédictions et simulations de l’IA, notre réalité commune est complexe et intriquée, et la théorie ne permet pas de prédire l’avenir. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas progresser vers des objectifs tels que la justice sociale et une transition juste, mais la dénumérisation suggère de les aborder de manière à la fois itérative et participative. Le véritable travail de restructuration réoriente l’attention des technologies toxiques vers le développement de techniques de redistribution du pouvoir social, telles que les conseils populaires et les assemblées populaires. Bref, pour sortir de l’enfermement des politiques publiques de l’abstraction qu’impose l’IA, il faut prendre un virage contraire, suggère McQuillan. Un constat qui n’est pas si éloigné de celui que dresse le chercheur Arvind Narayanan quand il invite à limiter l’emprise du calcul sur le social, même s’il est exprimé ici d’une manière bien plus radicale.
MAJ du 4/11/2025 : SynthMedia a eu la bonne idée de traduire un autre texte de Dan McQuillan. Pour lui, l’IA n’est rien d’autre qu’un « QAnon informatique », c’est-à-dire des modèles « dont la seule prise sur la réalité est la corrélation », à l’image de la mouvance conspirationniste d’extrême-droite, QAnon, capable de ne produire que confusion. Pour McQuillan, la dénumérisation, ou plutôt la désinformatisation voire la désautomatisation, est le levier pour imposer une forme de décroissance permettant de s’opposer à l’extractivisme de l’IA et ses logiques systémiques. « L’IA est une intensification des structures institutionnelles, bureaucratiques et marchandes qui dépouillent déjà les travailleurs et les communautés de leur agentivité pour la placer dans des mécanismes opaques et abstraits. Le decomputing, au contraire, consiste à démêler la pensée et les relations des influences réductrices de l’IA ». « Le decomputing consiste à développer des formes alternatives d’organisation et de prise de décision qui s’appuient plutôt sur le jugement réflexif et la responsabilité située ». Exiger la détermination sociale de la technologie, c’est-à-dire sa réappropriation par ceux qui la font et ceux qu’elle impacte, est une façon de défaire la perte d’action collective, résultat de décennies de néolibéralisme. C’est à retrouver cette capacité collective que nous invite le decomputing, à la fois pour résister à la vague montante fasciste et pour reconstruire de l’égalité sociale.