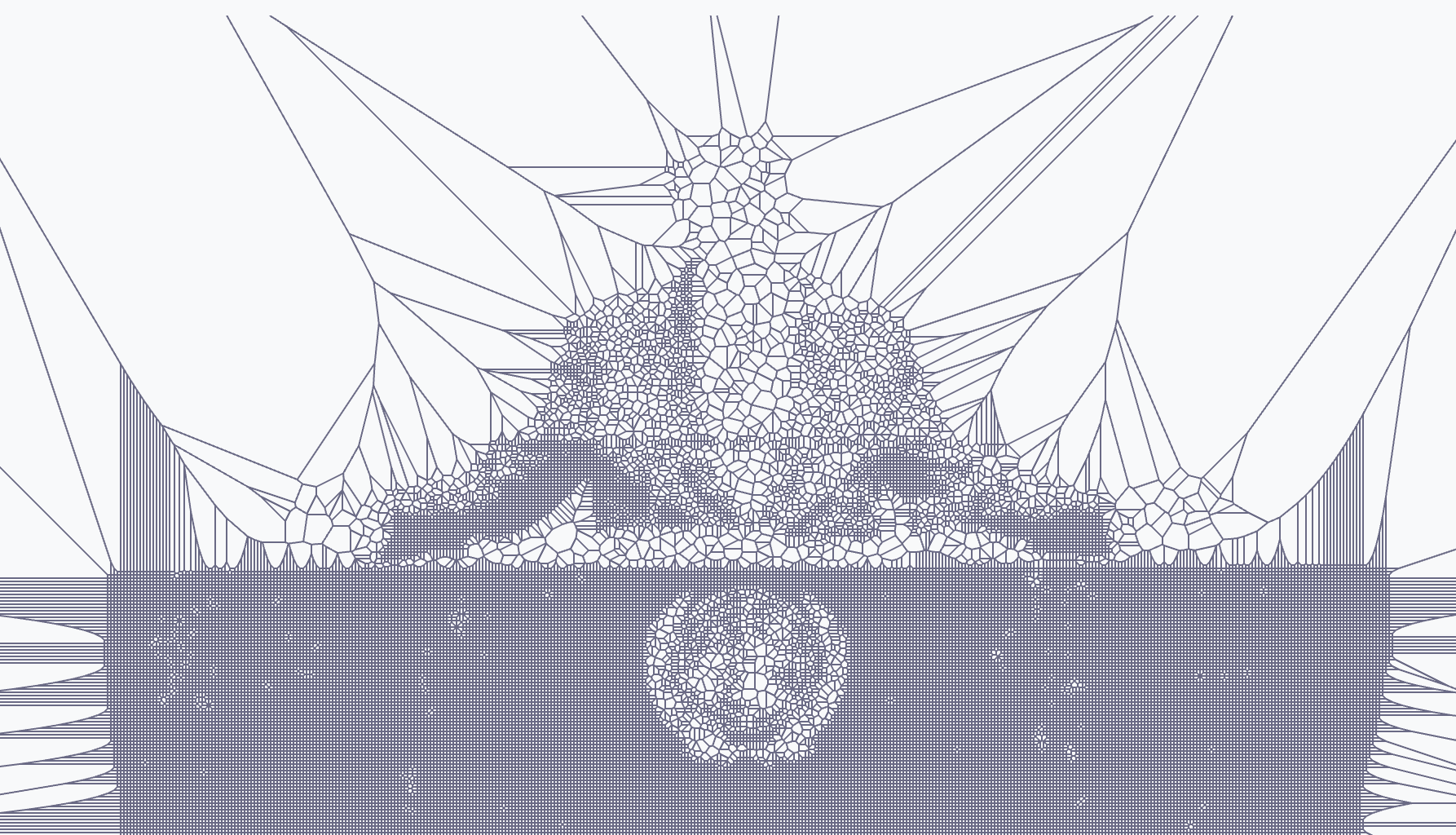Dans la même rubrique
A New York, l’Assemblée générale des Nations Unies a ouvert sa quatre-vingtième session. « Le podium de marbre, les drapeaux, les discours solennels, tout cela vous semblera familier : des présidents invoquant la démocratie, des Premiers ministres promettant de protéger les droits humains, des ministres des Affaires étrangères mettant en garde contre les dangers de l’autoritarisme. Le langage est toujours noble, le symbolisme toujours lourd ».
Mais, pendant que les délégués s’affairent à se féliciter de défendre la liberté, un coup d’État silencieux se déroule au cœur des infrastructures même d’internet, explique Konstantinos Komaitis dans une vibrante tribune pour Tech Policy Press. Pour le chercheur au Digital Forensics Research Lab (DFRLab) de l’Atlantic Council, un think tank américain, internet est largement devenu un outil de répression. Les rapports « le coup d’Etat d’internet » d’InterSecLab et celui de Follow the Money sur l’exportation par la Chine de ses technologies de censure sont « comme des dépêches venues des premières lignes de cette prise de contrôle ». Inspection des échanges, surveillance en temps réel, limitation du trafic, blocage des VPN… Les gouvernements sont les premiers à adhérer et acheter ces solutions, notamment en Asie et en Afrique, expliquait Wired. Mais ce n’est plus seulement le cas des autocraties… La professeure de droit Elizabeth Daniel Vasquez expliquait dans une longue enquête pour le New York Times, comment la police de New York a mis les New-Yorkais sous surveillance continue au nom de la lutte contre la criminalité. La police a mis en place d’innombrables dispositifs pour capter les données des habitants, qu’elle conserve sans mandat, lui permettant de reconstituer les parcours de nombre d’habitants, de connaître leurs échanges en ligne. Joseph Cox pour 404media vient de révéler que l’ICE, l’agence fédérale de l’immigration et des douanes américaines, venait d’acquérir un outil lui permettant de collecter d’innombrables données des téléphones des Américains et notamment de suivre leurs déplacements. Sous couvert de sécurité des réseaux, les messages sont surveillés, leur distribution empêchée, l’accès aux VPN désactivé. Et ces systèmes ne sont pas uniquement les créations de régimes paranoïaques, mais « des produits commerciaux vendus à l’international, accompagnés de manuels de formation, de contrats de maintenance et de supports techniques ». La censure est désormais une industrie qui repose bien souvent sur des technologies occidentales. « Les démocraties condamnent le contrôle autoritaire tandis que leurs entreprises contribuent à en fournir les rouages ». « L’hypocrisie est stupéfiante et corrosive ».
Les régimes autoritaires ont toujours cherché à museler la dissidence et à monopoliser les discours. Ce qui a changé, c’est l’industrialisation de ce contrôle. Il ne s’agit plus du pare-feu d’un seul pays ; il s’agit d’un modèle d’autoritarisme numérique mondial, dénonce Konstantinos Komaitis. La tragédie est que ce coup d’État progresse au moment même où les démocraties vacillent. Partout dans le monde, les institutions sont assiégées, la société civile s’affaiblit, la désinformation est omniprésente et la confiance en chute libre.
Dans ce contexte, la tentation d’adopter des outils de contrôle numérique est immense. Pourquoi ne pas bloquer des plateformes au nom de la « sécurité » ? Pourquoi ne pas surveiller les militants pour préserver la « stabilité » ?… Ce qui n’était au départ qu’une pratique autoritaire à l’étranger devient accessible, voire séduisante, aux démocraties en difficulté en Occident. Les normes évoluent en silence. Ce qui semblait autrefois impensable devient la norme. Et pendant ce temps, la promesse originelle d’Internet – comme espace de dissidence, de connexion et d’imagination – s’érode.
« La censure est désormais un bien d’exportation ». Et une fois ces infrastructures bien installées, elles sont extrêmement difficiles à démanteler. « Le coup d’État n’est pas métaphorique. Il s’agit d’une capture structurelle, d’une réécriture des règles, d’une prise de pouvoir – sauf qu’il se déroule au ralenti, presque invisiblement, jusqu’au jour où l’Internet ouvert disparaît ».
Les gouvernements démocratiques continueront-ils à faire de belles déclarations tandis que leurs propres entreprises aident à doter les régimes autoritaires d’outils de répression, comme c’est le cas en Chine ? L’ONU adoptera-t-elle à nouveau des résolutions qui paraissent nobles, mais qui resteront sans effet ? La société civile sera-t-elle laissée seule à lutter, sous-financée et dépassée ? Ou la communauté internationale reconnaîtra-t-elle enfin que la défense de l’Internet ouvert est aussi urgente que la défense de la souveraineté territoriale ou de la sécurité climatique. La réponse déterminera la réussite du coup d’État.
Contrôles à l’exportation des technologies de censure, exigences de transparence contraignantes pour les fournisseurs, sanctions en cas de complicité, soutien aux outils de contournement, investissement dans les organisations de défense des droits numériques : tout cela n’est pas un luxe, rappelle Komaitis. Ces mesures constituent le strict minimum si nous voulons préserver ne serait-ce qu’un semblant de l’esprit fondateur d’Internet. À la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les dirigeants mondiaux ont l’occasion de prouver qu’ils comprennent les enjeux, non seulement de l’architecture technique d’un réseau, mais aussi de l’architecture morale de la liberté mondiale. « S’ils échouent, s’ils détournent le regard, s’ils laissent ce coup d’État se poursuivre sans être contesté, alors l’Internet ouvert ne s’éteindra pas d’un coup. Il disparaîtra clic après clic, pare-feu après pare-feu, jusqu’au jour où nous nous réveillerons et découvrirons que l’espace autrefois annoncé comme la plus grande expérience d’ouverture de l’humanité n’est plus qu’un instrument de contrôle parmi d’autres. Et là, il sera trop tard pour riposter. »
Bon, il n’y a pas que les démocraties qui démantèlent l’internet libre et ouvert, bien sûr. Global Voices par exemple revient sur la manière dont le gouvernement russe restreint considérablement l’internet russe, notamment en créant une longue liste de sites à bloquer. Mais depuis peu, les autorités russes sont passés de la liste noire à la liste blanche, une liste de sites à ne pas bloquer, alors que les coupures du réseau sont de plus en plus fréquentes en Russie. Mais surtout, explique l’article, la Russie ne cible plus des plateformes ou des services individuels : « elle démantèle systématiquement l’infrastructure technique qui permet les communications internet gratuites, y compris les appels vocaux » ou l’accès aux VPN. Les censeurs russes identifient par exemple les protocoles VoIP (voix sur IP) quelle que soit l’application utilisée, pour les dégrader au niveau du protocole et non plus seulement seulement bloquer telle ou telle application (afin que même les nouvelles applications soient dégradées). « Toutes les messageries, qu’il s’agisse de WhatsApp, Telegram, Signal ou Viber, reposent sur les mêmes technologies sous-jacentes pour les appels vocaux : protocoles VoIP, WebRTC pour les appels via navigateur et flux de données UDP/TCP pour la transmission audio. Les censeurs russes peuvent désormais utiliser le DPI pour analyser les signatures de paquets et identifier les schémas de trafic VoIP en temps réel. Ils n’ont pas besoin de savoir si vous utilisez WhatsApp ou Telegram ; il leur suffit de reconnaître que vous passez un appel Internet et de le bloquer au niveau du protocole. C’est comme couper toutes les lignes téléphoniques au lieu de déconnecter chaque téléphone individuellement. » Ce contrôle au niveau des infrastructures est bien sûr regardé avec attention par bien d’autres autocraties, pour s’en inspirer.
Après avoir fait l’édifiante histoire de la censure de l’internet russe, la chercheuse Daria Dergacheva, qui signe l’article de Global Voices, explique que la Russie se dirige vers un réseau internet interne. Le risque à terme, c’est que l’internet russe se coupe totalement du reste de l’internet et se referme sur lui-même, sur le modèle de la Corée du Nord.