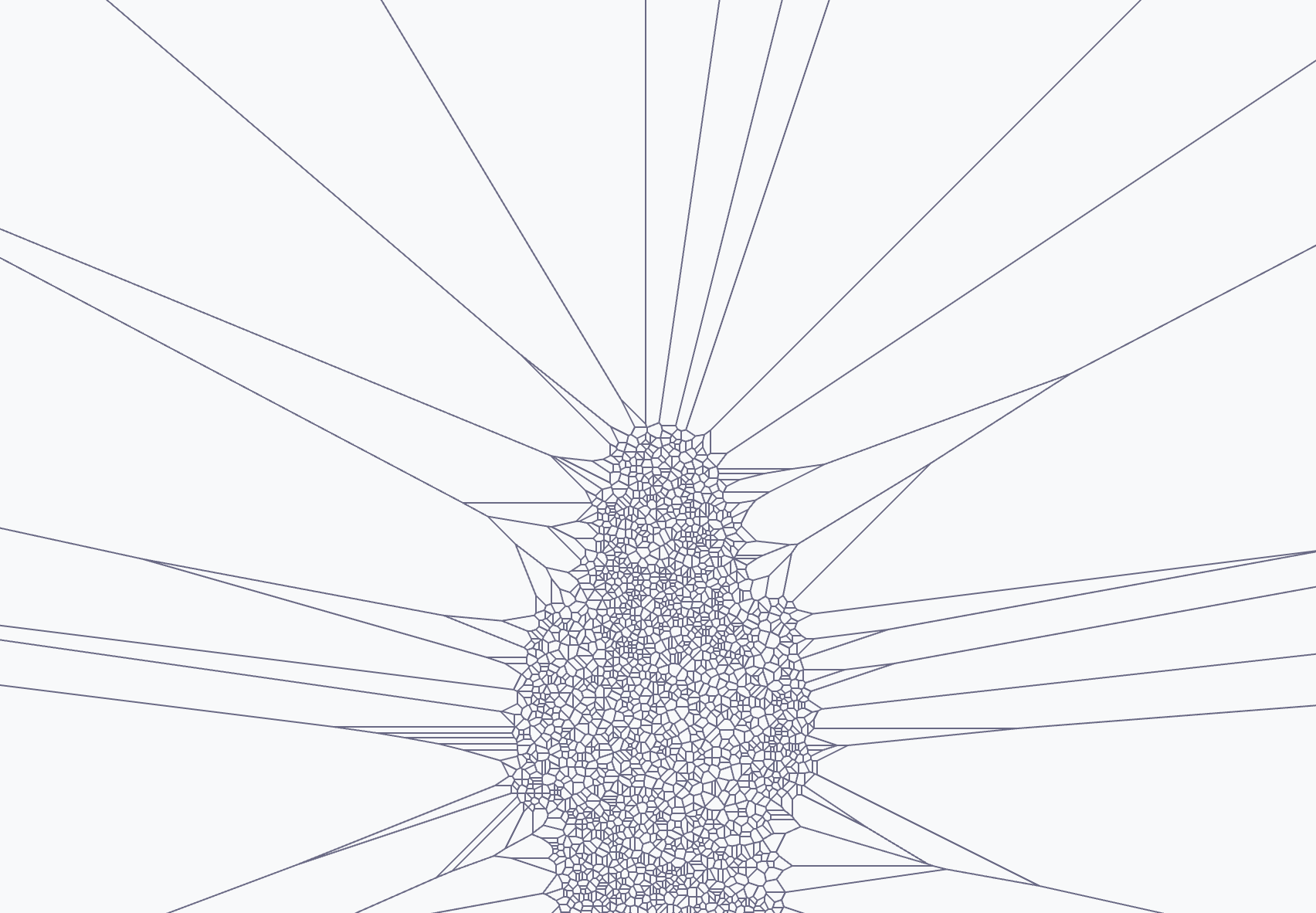Dans la même rubrique
Dans sa newsletter Blood in the Machine, l’historien Brian Merchant s’entretient avec le chercheur en sciences cognitives Hagen Blix qui vient de publier avec la spécialiste de l’IA, Ingeborg Glimmer, Pourquoi nous avons peur de l’IA (Why We Fear AI, Common Notions, 2025, non traduit). Dans leur livre, Blix et Glimmer passent en revue les craintes que génère l’IA, des peurs apocalyptiques à celles qui annoncent la destruction des emplois, même si personne ne croit vraiment ni aux unes ni aux autres. Or, ce qui est bien moins interrogé, parce que personne ne le voit comme un risque, c’est le fait que la technologie soit un moyen de produire des gains de productivité. C’est-à-dire le fait que de nombreuses technologies soient développées pour accroître le contrôle de la direction sur les lieux de travail et pour déqualifier les employés (comme le suggère le sociologue Juan Sebastian Carbonell dans son livre), c’est-à-dire en rémunérant des travailleurs auparavant qualifiés comme des travailleurs non qualifiés. « Il faut considérer l’IA comme un outil de baisse des salaires plutôt que comme un outil d’augmentation de la productivité ».
De nombreuses études indiquent que les augmentations de productivité ne sont pas au rendez-vous, malgré l’empressement de beaucoup à ânonner l’idée que l’IA leur ferait gagner du temps. Par contre, on constate dans de nombreux secteurs, que les emplois se dégradent, comme c’est le cas des traducteurs. Les machines savent produire des traductions de mauvaises qualités, mais pas au point d’être inutiles. Et « l’offre de cette version médiocre est si importante qu’elle fait baisser les prix et les salaires ».
Pour Blix, nous devrions considérer l’IA comme un outil de baisse des salaires plutôt que comme un outil d’augmentation de la productivité. Et si c’est le cas, il faut comprendre que la fin de l’essor de l’IA n’est pas pour demain, quand bien même la productivité n’augmente pas. C’est en cela qu’il faut entendre la peur sourde de l’IA. Elle est « un vecteur omnidirectionnel et omniprésent de déqualification ». Jusqu’à présent, dans tous les secteurs où l’on maniait le langage notamment, l’industrialisation était peu poussée. Or, la promesse de l’IA est bien celle d’une prolétarisation partout où elle s’infiltre. Pour Blix, l’IA permet de créer une « bifurcation » selon la valeur. Si vous êtes avocat spécialisé en fusion d’entreprises, vous avez peu de chance d’être remplacé par une IA, car la moindre erreur pourrait coûter des millions de dollars. Mais si vous êtes avocat commis d’office, l’IA va vous aider à traiter bien plus de dossiers, même si vous ne les gagnez pas tous. Pour Blix, les services coûteux vont l’être de plus en plus, alors que les services les moins coûteux seront peut-être moins chers encore, mais avec de moins en moins de garanties de qualité. « L’IA fabrique des produits tellement moins chers qu’ils surpassent la concurrence non pas en qualité, mais en prix ». Pour lui, c’est « une attaque d’en haut contre les salaires ».
Mais ce n’est pas une attaque à l’encontre de n’importe quels secteurs. Les secteurs que l’IA s’apprête à déstabiliser regroupent des emplois où les gens étaient relativement privilégiés et éduqués. Ils étaient ceux de gens qui « constituaient un rempart contre le système d’exploitation dans lequel nous vivons », même si beaucoup de ces personnes n’étaient jusqu’à présent pas forcément les plus syndiquées parce que pas nécessairement les plus hostiles au développement du capitalisme. C’est là quelque chose qui risque de bouger, esquisse Blix, comme quand les scénaristes et les acteurs se sont mis en grève l’année dernière, alors que ce n’était pas jusqu’alors un secteur très politisé. Brian Merchant dresse le même constat en évoquant des discussions avec des designers inquiets face à la précarisation qui les menace. Peut-être effectivement que ces perspectives vont faire réagir ceux dont les intérêts collectifs sont mis en danger.
« L’IA est un moyen de s’attaquer aux salaires et à la qualité du travail ». Sans compter que ces outils sont excellents à discipliner les travailleurs par les scripts qu’ils imposent. « Pourquoi vivons-nous dans une société où la technologie est conçue comme un outil permettant aux gens d’avoir moins de contrôle sur leur travail ? La technologie devrait être développée de manière à rendre le travail plus agréable. Mais les intérêts de ceux qui financent la technologie, les entreprises et les patrons, sont souvent hostiles à ceux des travailleurs, car ces derniers souhaitent faire les choses différemment. On veut que son travail soit confortable, intéressant et peut-être convivial, mais l’entreprise cherche à exercer un contrôle », une pression, notamment pour que le travail lui coûte le moins possible. Par nature, il y a une forme d’hostilité intrinsèque à l’égard de ceux qu’elle emploie. « Les Luddites n’étaient pas opposés à la technologie. Ils étaient opposés à la technologie comme outil d’écrasement de la classe ouvrière ». Et il est probable que nous ayons à nous opposer à l’IA comme outil d’écrasement de toutes les autres.
Le but d’un système est ce qu’il fait
Dans un article pour le site Liberal Currents, Blix et Glimmer vont plus loin encore. Ils estiment que dénoncer la hype de l’IA ne nous mène nulle part. Qualifier l’IA de bulle, d’escroquerie ou de poudre de perlimpimpin ne nous aide à comprendre ni à agir. Même si le battage médiatique de l’intelligence artificielle était moins fort, les problèmes qu’elle cause persisteraient. Pour les deux auteurs, il nous faut mieux qualifier son utilité pour saisir ce qu’elle accomplit réellement.
Elle est d’abord massivement utilisée pour produire de la désinformation et de la propagande, c’est-à-dire manipuler nos émotions et amplifier nos résonances affectives. Elle est d’abord le moyen « d’innonder la zone de merde », comme le recommande le stratège extrêmiste Steve Bannon. Elle sert d’abord « à attiser sans relâche le scandale et l’indignation jusqu’à ce que personne ne puisse plus suivre les attaques contre la démocratie, la science, les immigrants, les Noirs, les personnes queer, les femmes, les anciens combattants ou les travailleurs. L’objectif : faire perdre aux gens le sens de ce qui se passe, de la réalité, afin qu’ils soient politiquement paralysés et incapables d’agir. » Les productions de l’IA générative n’y arrivent certainement pas toutes seules, mais reconnaissons qu’elles ont largement participé de la confusion ambiante ces dernières années. « Le fascisme, quant à lui, est engagé dans un jeu de pouvoir et d’esthétique qui considère le désir de vérité comme un aveu de faiblesse. Il adore les générateurs de conneries, car il ne peut concevoir un débat que comme une lutte de pouvoir, un moyen de gagner un public et des adeptes, mais jamais comme un processus social visant à la délibération, à l’émancipation ou au progrès vers la vérité. Les fascistes tentent, bien sûr, d’exploiter les conditions mêmes du discours (la volonté de présumer la bonne foi, de considérer l’égalité sinon comme une condition, du moins comme un objectif louable de progrès social, etc.). Prenons, par exemple, les débats sur la liberté d’expression comme un moyen pour retourner l’ennemi (c’est-à-dire nous). Les fascistes proclament sans cesse leur défense et leur amour de la liberté d’expression. Ils arrêtent également des personnes pour avoir proféré des discours, interdisent des livres » et s’en prennent à tous ceux qui n’expriment pas les mêmes idées qu’eux. « Considérer cela comme une incohérence, ou une erreur intellectuelle, revient à mal comprendre le projet lui-même : les fascistes ne cherchent pas la cohérence, ni à créer un monde rationnel et raisonnable, régi par des règles que des personnes libres et égales se donnent. Cette contradiction apparente s’inscrit plutôt dans la même logique stratégique que l’inondation de la zone de merde : utiliser tous les outils nécessaires pour accroître son pouvoir, renforcer les hiérarchies et consolider ses privilèges.»
« Cette attaque politique contre la possibilité d’un discours de bonne foi est-elle favorisée par le battage médiatique ? La situation serait-elle meilleure si les modèles étaient améliorés ou si la publicité était atténuée ? Ou est-ce plutôt l’incapacité des modèles à distinguer les mots du monde qui les rend si utiles aux visées fascistes ? Si tel est le cas, qualifier l’IA de battage médiatique revient à penser que les fascistes sont simplement stupides ou qu’ils commettent une erreur en étant incohérents. Mais les fascistes ne se trompent ni sur la nature de la liberté d’expression, ni sur la nature du « discours » produit par un LLM. Ils savent ce qu’ils veulent, ce qu’ils font et où cela mène. »
Ensuite, l’IA est un outil de terreur politique. Outil de la surveillance et du contrôle, le développement de l’IA tout azimut impose peu à peu sa terreur. Actuellement, le gouvernement américain utilise l’IA pour analyser les publications sur les réseaux sociaux à un niveau sans précédent et recueillir des « renseignements » à grande échelle. L’initiative « Catch and Revoke » du département d’État, par exemple, utilise l’IA pour annuler les visas des étrangers dont les propos ne sont pas suffisamment alignés avec les objectifs de politique étrangère du gouvernement. « S’agit-il d’un problème de battage médiatique ? Non ! »
« Qualifier l’IA de « battage médiatique » met en évidence un écart entre un argument de vente et les performances réelles du modèle. Lorsqu’un modèle à succès est mis en pratique, il commet des « erreurs » (ou en commet à une fréquence déraisonnable). Qu’en est-il des outils d’IA du département d’État ? Leur IA de surveillance des étudiants commettra certainement des « erreurs » : elle signalera des personnes qui ne sont pas titulaires de visas étudiants ou des personnes pour des propos sans rapport avec le sujet », sans que ces erreurs ne soient décisives, au contraire. L’expulsion de gens qui n’avaient pas à l’être n’est qu’un dommage collatéral sans importance. Alors peut-être que quelqu’un au département d’État s’est laissé prendre et a réellement cru que ces modèles surveillaient mieux qu’ils ne le font en réalité. Nous n’en savons rien. Mais le sujet n’est pas là !
La journaliste et chercheuse Sophia Goodfriend qualifie toute cette affaire de « rafle de l’IA » et observe avec perspicacité : « Là où l’IA échoue techniquement, elle tient ses promesses idéologiques ». Indubitablement, des personnes sont faussement classées comme ayant tenu des propos non autorisés par les défenseurs autoproclamés de la liberté d’expression. Mais ces erreurs de classification ne sont des erreurs qu’au sens strict du terme. Le but du département d’Etat de Marco Rubio est d’augmenter les expulsions et de supprimer certains types de discours, pas d’être précis. En fait, ce programme politique vise surtout l’échelle, le traitement de masse, c’est-à-dire atteindre le plus grand nombre de personnes. Et pour cela, l’IA est particulièrement efficace.
« Dans notre livre, nous affirmons que c’est précisément leur nature, sujette aux erreurs, leurs fragilités, qui rend l’IA si efficace pour la répression politique. C’est l’imprévisibilité des personnes qui seront prises dans ses filets, et l’insondabilité de la boîte noire de l’IA qui rendent ces outils si efficaces pour générer de l’anxiété, et qui les rendent si utiles pour la suppression de la parole ». Et les deux auteurs de comparer cela à la reconnaissance faciale. « Certes, les dommages causés par les erreurs d’identification des personnes causées par les systèmes de reconnaissances faciales sont bien réels. Reconnaissons d’abord que même si les algorithmes étaient parfaits et ne se trompaient jamais, ils favoriseraient tout de même un système raciste qui vise souvent à produire une déshumanisation violente… Mais aujourd’hui, les algorithmes de la reconnaissance faciale commettent bel et bien des erreurs d’identification, malgré leurs prétentions. Qualifier cela de « bêtise » nous aide-t-il à comprendre le problème ?»
Les « erreurs d’identification de la reconnaissance faciale ne sont pas distribuées aléatoirement, bien au contraire. Lorsque les erreurs de l’IA sont si clairement réparties de manière inégale et qu’elles sont source de préjudices – de fausses arrestations et de possibles violences policières –, il est évidemment inutile de les qualifier simplement d’« erreurs », de « bêtise » ou de théoriser cela à travers le prisme du « battage médiatique ». Ce que ce système produit, ce ne sont pas des erreurs, c’est de la terreur. Et cette terreur a une histoire et des liens évidents avec la pseudoscience et les structures politiques racistes : de la phrénologie à la reconnaissance faciale, de l’esclavage aux lois Jim Crow – jusqu’aux nouveaux Jim Crow qu’évoquaient Michelle Alexander ou Ruha Benjamin. Une fois ces liens établis, le caractère semi-aléatoire, les « erreurs », les « fausses » arrestations apparaissent non pas comme des accidents, mais comme faisant partie intégrante de l’IA en tant que projet politique. »
Ces erreurs non-aléatoires se situent précisément dans l’écart entre le discours commercial et la réalité. C’est cet écart qui offre un déni plausible aux entreprises comme aux politiques. « C’est l’algorithme qui a foiré », nous diront-ils sans doute, et que, par conséquent, personne n’est réellement responsable des fausses arrestations racistes. « Mais le fait même que les erreurs d’identification soient prévisibles au niveau des populations (on sait quels groupes seront le plus souvent mal identifiés), et imprévisibles au niveau individuel (personne ne sait à l’avance qui sera identifié de manière erronée) renforce également son utilité pour le projet politique de production de terreur politique : il s’agit, là encore, de susciter le sentiment généralisé que « cela pourrait arriver à n’importe lequel d’entre nous ». Cela est aussi vrai pour l’IA que pour d’autres outils plus anciens de terreur politique et d’intimidation policière. Pourtant, personne n’a jamais suggéré que les arguments de vente pour les armes « non létales » comme les balles en caoutchouc étaient du battage médiatique. Une balle en caoutchouc peut parfois aveugler, voire tuer, et il s’agit là aussi d’une « erreur » distribuée de manière semi-aléatoire, un écart entre l’argumentaire et la réalité. Les balles en caoutchouc, comme l’IA de surveillance et le système de reconnaissance faciale, fonctionnent comme des outils de contrôle politique, précisément parce que cet écart est fonctionnel, et non accessoire, au système ». Pour reprendre les termes du cybernéticien Stafford Beer, « il est inutile de prétendre que la finalité d’un système est de faire ce qu’il échoue constamment à faire ». « Le but d’un système est ce qu’il fait », disait-il. Et se concentrer principalement sur ce que le système ne peut pas réellement faire (comme le fait le battage médiatique) risque de détourner l’attention de ce qu’il fait réellement.
Enfin, l’IA est un outil pour écraser les salaires, défendent les deux auteurs. Des critiques comme celles d’Emily Bender et Alex Hanna ont, à juste titre, souligné que l’affirmation de notre remplacement par les machines – et leur répétition incessante par des médias peu critiques – sont essentiellement des formes de publicité pour ces outils. Pour Blix et Glimmer, « ce discours s’adresse avant tout aux investisseurs et aux entreprises clientes pour qui remplacer les travailleurs par des outils pourrait être bénéfique pour leurs résultats. Pour les travailleurs, ces mots ne sonnent certainement pas comme de la publicité, mais comme une menace ». A ces derniers on conseille de se mettre à l’IA avant que la concurrence ne les écrase et que leur emploi ne se délocalise dans cette nouvelle machinerie. Plutôt que de se défendre, on leur conseille par avance d’accepter l’inéluctable. « Taisez-vous et réduisez vos attentes, car vous êtes remplaçables !», tel est le refrain ambiant.
« C’est le suffixe « -able » dans « remplaçable » qui est crucial ici. Pour la menace, c’est l’évocation de la possibilité d’un remplacement qui compte. C’est ce que la loi de l’offre et de la demande implique en matière d’offre de personnes (dotées de compétences particulières) : une offre accrue d’un substitut potentiel (l’IA) entraînera une baisse du prix d’une marchandise (le salaire des travailleurs). »
Le discours de l’inéluctabilité de l’IA, de la formation comme seule réponse, porte également une teneur fortement antisyndicale, qui « trahit le véritable objectif économique de l’IA : c’est un outil pour faire baisser les salaires ». « Et pour atteindre cet objectif, la capacité réelle de l’outil à remplacer le travail effectué par des personnes à qualité égale est souvent sans importance. Après tout, la remplaçabilité ne se résume pas à une simple équivalence, mais le plus souvent à un compromis qualité-prix. Les gens aiment acheter ce qu’ils estiment être le meilleur rapport qualité-prix. Les entreprises font de même, substituant souvent des intrants moins chers (compétences, matériel, etc.) pour réduire leurs coûts, même si cela nuit à la qualité. C’est l’horizon évident de l’IA : non pas l’automatisation complète, mais le modèle de la fast fashion ou d’Ikea : proposer une qualité inférieure à des prix nettement inférieurs ». D’ailleurs, rappellent Blix et Glimmer, les arguments de vente d’Ikea ou de la fast fashion exagèrent eux aussi souvent la qualité de leurs produits.
« Des codeurs aux assistants juridiques, des tuteurs aux thérapeutes, les investissements pour produire des versions bon marché assistées par IA sont en bonne voie, et ils vont probablement faire baisser les salaires ». Les stratégies seront certainement différentes selon les métiers. Reste que L’attaque contre les travailleurs, la qualité des emplois et la qualité des produits que nous produisons et consommons est le problème que produit l’IA, et ce problème existe indépendamment du battage médiatique. « À moins d’être un investisseur en capital-risque, vous n’êtes pas la cible de la publicité pour l’IA, vous êtes la cible de la menace. Nous n’avons que faire de termes comme la hype qui avertissent les investisseurs qu’ils pourraient faire de mauvais investissements ; nous avons besoin de termes utiles pour riposter.»
L’éclatement à venir de la bulle de l’IA n’explique par pourquoi l’information est inondée de merde, n’explique pas pourquoi les erreurs des systèmes du social vont continuer. La dénonciation de la bulle et de la hype est finalement « étroitement technique, trop axée sur l’identification des mensonges, plutôt que sur l’identification des projets politiques ». Il ne faut pas commettre l’erreur de penser que le simple fait qu’une déclaration soit mensongère suffit à la négliger. Nous devrions prendre les mensonges bien plus au sérieux, car ils sont souvent révélateurs d’autre chose, même s’ils ne sont pas vrais.
Pour Blix et Glimmer nous devons nous concentrer sur les projets politiques. « Nous devons appeler l’IA pour ce qu’elle est : une arme entre les mains des puissants. Prenons le projet de dépression salariale au sérieux : appelons-le une guerre des classes par l’emmerdification, la lutte antisyndicale automatisée, une machine à conneries pour des boulots à la con, ou encore le techno-taylorisme…» « Désemmerdifions le monde ! »