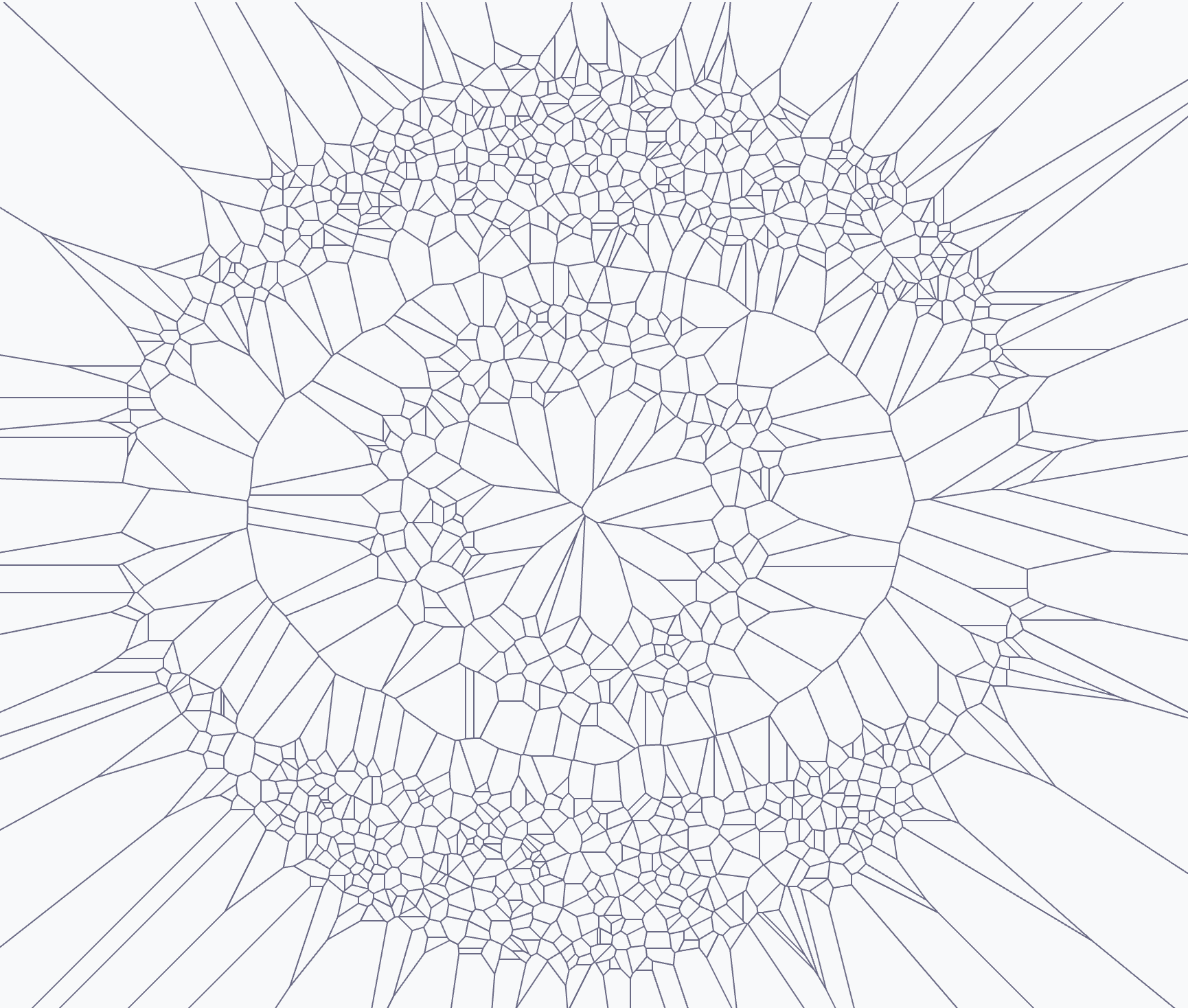Dans la même rubrique
- ↪ Vérification d’âge (3/4) : la panique morale en roue libre
- ↪ Vérification d’âge (2/4) : de l’impunité des géants à la criminalisation des usagers
- ↪ Vérification d’âge (1/4) : vers un internet de moins en moins sûr
- ↪ Après le Doge, les Doges !
- ↪ Politiques publiques : passer de l’IA… à la dénumérisation
Comment répondre à la gestion algorithmique du travail ? Tel est l’ambition du rapport « Negotiating the Algorithm » publié par la Confédération européenne des syndicats sous la direction du journaliste indépendant Ben Wray, responsable du Gig Economy Project de Brave New Europe. Le rapport décrit la prédominance des logiciels managériaux au travail (qui seraient utilisés par plus de 79% des entreprises de l’Union européenne) et les abus qui en découlent et décrit les moyens de riposte mobilisables par les travailleurs en lien notamment avec la nouvelle législation européenne des travailleurs des plateformes. La gestion algorithmique confère aux employeurs des avantages informationnels considérables sur les travailleurs, leur permet de contourner les conventions collectives et de modifier les conditions de travail et les salaires de chaque travailleur voire de chaque poste. Elle leur permet d’espionner les travailleurs même en dehors de leurs heures de travail et leur offre de nombreuses possibilités de représailles.
En regard, les travailleurs piégés par la gestion algorithmique sont privés de leur pouvoir d’action et de leurs possibilités de résolution de problèmes, et bien souvent de leurs droits de recours, tant la gestion algorithmique se déploie avec de nombreuses autres mesures autoritaires, comme le fait de ne pouvoir joindre le service RH.
Il est donc crucial que les syndicats élaborent une stratégie pour lutter contre la gestion algorithmique. C’est là qu’intervient la directive sur le travail de plateforme qui prévoit des dispositions assez riches, mais qui ne sont pas auto-exécutoires… C’est-à-dire que les travailleurs doivent revendiquer les droits que la directive propose, au travail comme devant les tribunaux. Or, elle permet aux travailleurs et à leurs représentants d’exiger des employeurs des données exhaustives sur les décisions algorithmiques, du licenciement au calcul du salaire.
Bien souvent ces données ne sont pas rendues dans des formats faciles à exploiter, constate Wray : le rapport encourage donc les syndicats à constituer leurs propres groupes d’analyses de données. Le rapport plaide également pour que les syndicats développent des applications capables de surveiller les applications patronales, comme l’application UberCheats, qui permettait de comparer le kilométrage payé par Uber à ses livreurs par rapport aux distances réellement parcourues (l’application a été retirée en 2021 au prétexte de son nom à la demande de la firme Uber). En investissant dans la technologie, les syndicats peuvent combler le déficit d’information des travailleurs sur les employeurs. Wray décrit comment les travailleurs indépendants ont créé des « applications de contre-mesure » qui ont documenté les vols de salaires et de pourboires (voir notre article “Réguler la surveillance au travail”), permis le refus massif d’offres au rabais et aidé les travailleurs à faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Cette capacité technologique peut également aider les organisateurs syndicaux, en fournissant une plateforme numérique unifiée pour les campagnes syndicales dans tous les types d’établissements. Wray propose que les syndicats unissent leurs forces pour créer « un atelier technologique commun » aux travailleurs, qui développerait et soutiendrait des outils pour tous les types de syndicats à travers l’Europe.
Le RGPD confère aux travailleurs de larges pouvoirs pour lutter contre les abus liés aux logiciels de gestion, estime encore le rapport. Il leur permet d’exiger le système de notation utilisé pour évaluer leur travail et d’exiger la correction de leurs notes, et interdit les « évaluations internes cachées ». Il leur donne également le droit d’exiger une intervention humaine dans les prises de décision automatisées. Lorsque les travailleurs sont « désactivés » (éjectés de l’application), le RGPD leur permet de déposer une « demande d’accès aux données » obligeant l’entreprise à divulguer « toutes les informations personnelles relatives à cette décision », les travailleurs ayant le droit d’exiger la correction des « informations inexactes ou incomplètes ». Malgré l’étendue de ces pouvoirs, ils ont rarement été utilisés, en grande partie en raison de failles importantes du RGPD. Par exemple, les employeurs peuvent invoquer l’excuse selon laquelle la divulgation d’informations révélerait leurs secrets commerciaux et exposerait leur propriété intellectuelle. Le RGPD limite la portée de ces excuses, mais les employeurs les ignorent systématiquement. Il en va de même pour l’excuse générique selon laquelle la gestion algorithmique est assurée par un outil tiers. Cette excuse est illégale au regard du RGPD, mais les employeurs l’utilisent régulièrement (et s’en tirent impunément).
La directive sur le travail de plateforme corrige de nombreuses failles du RGPD. Elle interdit le traitement des « données personnelles d’un travailleur relatives à : son état émotionnel ou psychologique ; l’utilisation de ses échanges privés ; la captation de données lorsqu’il n’utilise pas l’application ; concernant l’exercice de ses droits fondamentaux, y compris la syndicalisation ; les données personnelles du travailleur, y compris son orientation sexuelle et son statut migratoire ; et ses données biométriques lorsqu’elles sont utilisées pour établir son identité. » Elle étend le droit d’examiner le fonctionnement et les résultats des « systèmes décisionnels automatisés » et d’exiger que ces résultats soient exportés vers un format pouvant être envoyé au travailleur, et interdit les transferts à des tiers. Les travailleurs peuvent exiger que leurs données soient utilisées, par exemple, pour obtenir un autre emploi, et leurs employeurs doivent prendre en charge les frais associés. La directive sur le travail de plateforme exige une surveillance humaine stricte des systèmes automatisés, notamment pour des opérations telles que les désactivations.
Le fonctionnement de leurs systèmes d’information est également soumis à l’obligation pour les employeurs d’informer les travailleurs et de les consulter sur les « modifications apportées aux systèmes automatisés de surveillance ou de prise de décision ». La directive exige également que les employeurs rémunèrent des experts (choisis par les travailleurs) pour évaluer ces changements. Ces nouvelles règles sont prometteuses, mais elles n’entreront en vigueur que si quelqu’un s’y oppose lorsqu’elles sont enfreintes. C’est là que les syndicats entrent en jeu. Si des employeurs sont pris en flagrant délit de fraude, la directive les oblige à rembourser les experts engagés par les syndicats pour lutter contre les escroqueries.
Wray propose une série de recommandations détaillées aux syndicats concernant les éléments qu’ils devraient exiger dans leurs contrats afin de maximiser leurs chances de tirer parti des opportunités offertes par la directive sur le travail de plateforme, comme la création d’un « organe de gouvernance » au sein de l’entreprise « pour gérer la formation, le stockage, le traitement et la sécurité des données. Cet organe devrait inclure des délégués syndicaux et tous ses membres devraient recevoir une formation sur les données. »
Il présente également des tactiques technologiques que les syndicats peuvent financer et exploiter pour optimiser l’utilisation de la directive, comme le piratage d’applications permettant aux travailleurs indépendants d’augmenter leurs revenus. Il décrit avec enthousiasme la « méthode des marionnettes à chaussettes », où de nombreux comptes tests sont utilisés pour placer et réserver du travail via des plateformes afin de surveiller leurs systèmes de tarification et de détecter les collusions et les manipulations de prix. Cette méthode a été utilisée avec succès en Espagne pour jeter les bases d’une action en justice en cours pour collusion sur les prix.
Le nouveau monde de la gestion algorithmique et la nouvelle directive sur le travail de plateforme offrent de nombreuses opportunités aux syndicats. Cependant, il existe toujours un risque qu’un employeur refuse tout simplement de respecter la loi, comme Uber, reconnu coupable de violation des règles de divulgation de données et condamné à une amende de 6 000 € par jour jusqu’à sa mise en conformité. Uber a maintenant payé 500 000 € d’amende et n’a pas divulgué les données exigées par la loi et les tribunaux.
Grâce à la gestion algorithmique, les patrons ont trouvé de nouveaux moyens de contourner la loi et de voler les travailleurs. La directive sur le travail de plateforme offre aux travailleurs et aux syndicats toute une série de nouveaux outils pour contraindre les patrons à jouer franc jeu. « Ce ne sera pas facile, mais les capacités technologiques développées par les travailleurs et les syndicats ici peuvent être réutilisées pour mener une guerre de classes numérique totale », s’enthousiasme Cory Doctorow.
MAJ du 18/11/2025 : Le Centre du travail de l’Université de Californie à Berkeley recense plus de 350 projets de lois et lois sur les technologies, déposés par les syndicats ou ayant un impact direct sur les travailleurs américains. Pour Tech Policy Press, les chercheuses Mishal Khan et Annette Bernhardt du Technology and Work Program livrent une rapide analyse des tendances.
Elles constatent que « malgré l’absence de législation au niveau fédéral et un climat général hostile à la réglementation dans les assemblées législatives des États, les progrès réalisés cette année sont remarquables ». Avec notamment beaucoup de projets de lois qui tentent de réglementer la surveillance électronique et la gestion algorithmique, notamment en ce qui concerne les discriminations qu’elles produisent et les pratiques abusives, comme le licenciement automatisé. Ces lois tentent de garantir que les travailleurs obtiennent des informations sur les algorithmes utilisés et accordent souvent le droit de faire appel. Certains de ces projets de loi interdisent certaines pratiques telles que le profilage prédictif des travailleurs et la fixation individualisée des salaires. Aucun de ces projets de lois n’ont été adoptés pour l’instant, rappellent les chercheuses, mais ces propositions sont néanmoins, une perspective prometteuse.
D’autres projets de loi visent à interdire le remplacement de certaines professions par les technologies numériques (comme les enseignants, les journalistes, les professionnels de la santé mentale, les infirmiers, les vendeurs, les traducteurs…). Enfin, un ensemble de projets réglementaires visent à établir des règles garantissant que l’humain reste toujours impliqué et conserve le pouvoir de décision final.
Enfin, l’analyse a également montré « une augmentation sans précédent du lobbying des entreprises technologiques contre les projets de loi réglementant l’IA, notamment ceux visant à protéger les travailleurs ». En contrepartie, remarquent les chercheuses, nombre de projets de lois n’étaient pas portés par des syndicats, mais par des organisations de la société civile, comme des associations professionnelles et des associations de consommateurs, montrant que la contestation se déploie et se renforce.