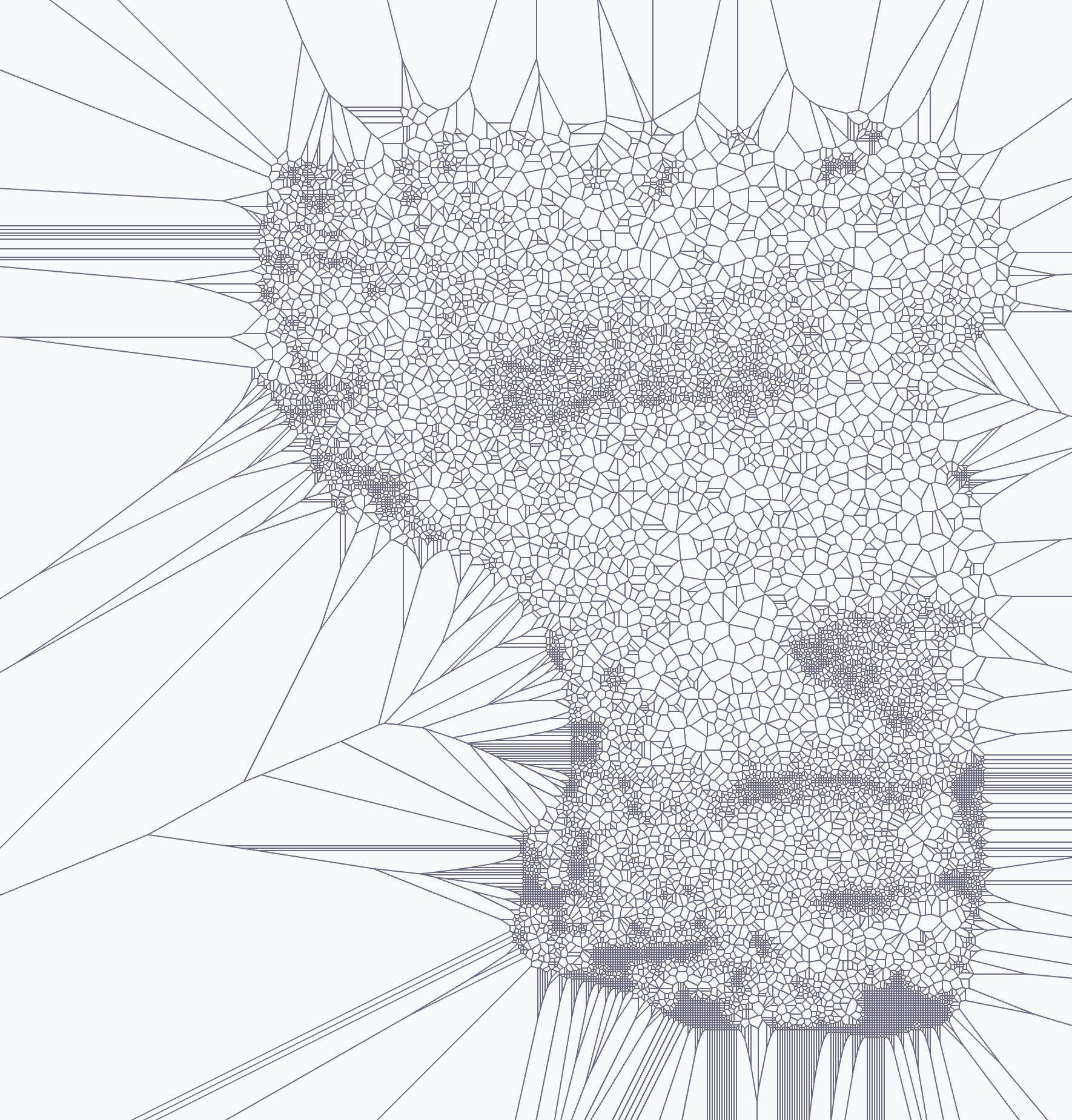Dans la même rubrique
« Pendant plus d’un siècle, les marchands d’attention ont régné en maîtres [voir notre recension du livre éponyme de Tim Wu – NDE], du sensationnalisme au clickbait, des radios à sensation aux réseaux sociaux. Mais cet empire s’effondre. Les grands éditeurs ont perdu 50 % de leur trafic lorsque Google a opté pour les classements basés sur l’IA. Le secteur de la publicité numérique, qui pèse 685 milliards de dollars, est confronté à une crise existentielle : les assistants vocaux IA cessent de cliquer sur les publicités. Le SEO, cet art obscur qui a façonné deux décennies de contenu web, a commencé à se fissurer dès l’instant où les moteurs de recherche ont cessé de diriger les internautes vers les sites web », explique Shuwei Fang, directrice associée des programmes de l’Open Society Foundations, dans une tribune pour le Shorenstein Center de Harvard.
Construire le « graphe de la curiosité »
Pour elle, l’IA vise à produire un « graphe de la curiosité » des utilisateurs, qui n’est plus le graphe social des premiers réseaux sociaux ni le graphe des centres d’intérêts (ces étiquettes collés à nos profils en fonction de nos actions, comme l’expliquait Tim Hwang) permettant de cibler la publicité de la seconde génération des réseaux sociaux, mais la cartographie de l’évolution de vos centres d’intérêts au fil du temps. Vos incertitudes émergentes seraient commercialisées sous forme de produits dérivés, votre assistant IA pouvant potentiellement parier sur votre prochaine question. Nous voici en train d’entrer dans ce que certains baptisent « l’économie de l’intention », où « les systèmes d’IA collectent, commercialisent et manipulent potentiellement l’intention des utilisateurs ».
Mais ce constat déjà inquiétant n’est que la partie émergée de l’iceberg, estime Shuwei Fang. Nous assistons à une restructuration fondamentale de la circulation de l’information dans la société [voir également notre article sur le remplacement du web par l’IA]. Dans cette économie de l’intention qui émerge, les systèmes d’IA pourraient rivaliser pour anticiper et façonner les recherches des utilisateurs avant même qu’ils n’en aient conscience. L’infrastructure en cours de construction, largement invisible pour la plupart d’entre nous, ne déterminera pas seulement ce que nous voyons, elle déterminera ce que nous voulons voir avant même que nous le sachions.
Pour comprendre comment l’intention remplace l’attention, il faut examiner l’inversion fondamentale qui s’opère dans le flux d’informations. Lorsqu’on pose une question à une IA aujourd’hui, elle dispose généralement d’énormément d’éléments de contexte pour élaborer sa réponse. Cela représente un changement structurel dans la circulation de l’information au sein de la société. Pour Shuwei Fang, nous entrons dans un monde « B2A2C », expliquait-elle pour SpliceMedia (voir la traduction sur Meta Media), c’est-à-dire un monde où les contenus suivent une nouvelle chaîne logistique, Business to Agent to Consumer (de l’entreprise à l’agent IA, puis au consommateur). Les contenus ne sont plus conçus pour seulement capter l’attention, mais doivent être également structurés pour être lisibles par les machines. « L’IA constitue à la fois un nouveau public et un nouvel intermédiaire » au risque que la « relation directe entre humains se réduise de manière drastique », notamment parce que « les contenus optimisés pour les humains deviennent relativement onéreux à créer et à diffuser ». Pour Fang, les humains dépendront d’interfaces de plus en plus complexes pour accéder à l’information pensée pour les machines et ceux qui produisent les contenus ne sont plus appelés à produire des histoires mais à saisir des données. « La couche de traduction Agent to consumer, où l’IA retranscrit l’information optimisée pour les machines à destination des humains, est le véritable lieu du basculement de pouvoir. Nous passons d’un pouvoir éditorial — celui de choisir quelles histoires raconter — à un pouvoir architectural : concevoir les structures par lesquelles l’information circule des machines vers les esprits humains ».
… ou y résister
Pour Fang, pour éviter cette capture, c’est-à-dire le fait d’être inféré, d’être nous-mêmes hallucinés, l’enjeu dès lors consiste à « construire des couches de traduction qui renforcent le pouvoir d’agir des humains, au lieu de le remplacer ». C’est-à-dire rendre cette traduction visible (à l’image des tableaux de bord qu’imaginait Fernanda Viegas, permettant de comprendre les facteurs qui façonnent le contenu que les utilisateurs reçoivent des réponses des modèles d’IA générative), créer des structures de gouvernance permettant aux individus de moduler leur propre accès au sens, concevoir des dispositifs permettant de montrer quels schémas conduisent à telle ou telle conclusion et surtout garantir la coexistence de multiples options de traduction. Cela passe par exemple par le développement d’outils capables de garantir la provenance et l’intégrité des contenus, comme les travaux de Truepic ou de la Content authenticity Initiative. Ou encore en intégrant de l’IA dans des plateformes hyperlocales, capables de produire de l’information où le contexte reste sous la surveillance des communautés locales ou thématiques. Cela pourrait passer par des interfaces de traduction capables d’établir une relation durable avec les utilisateurs finaux, comme quand Perplexity affiche ses sources et ses chaînes de raisonnement ou par des outils qui favorisent la compréhension plus que l’engagement, comme l’esquissait Anthropic avec Consitutional AI, où les utilisateurs ajusteraient eux-mêmes les valeurs et priorités des couches de traduction qu’ils mobilisent.
Ce qui est sûr, estime Fang, c’est que, contrairement à l’ère des plateformes, l’information est en passe de devenir la matière première des machines plus que des humains. Google organisait les liens vers des pages que les humains lisaient. Facebook mettait en avant les publications de votre réseau. Ces plateformes avaient une influence algorithmique, mais pas de pouvoir d’action ; elles ne pouvaient pas créer de contenu, seulement classer celui existant.
Les systèmes d’IA ont un pouvoir d’action fonctionnel : ils transforment les sources d’information en des formes entièrement nouvelles. Cette information n’est plus statique ni permanente. Elle devient « liquide », constamment reformée en fonction de la personne qui pose la question et de la manière dont elle la pose. Ils ne se contentent pas de sélectionner des options ; ils génèrent de nouvelles réalités. « Lorsqu’une IA synthétise une réponse, elle ne vous oriente pas vers une information, elle crée une information qui n’a jamais existé sous cette forme précise auparavant. Chaque réponse est spécifique à une intention, façonnée non pas par ce qui existe, mais par ce que vous cherchez à savoir », selon ce que la machine en calcule
« Cette intermédiation par les machines ne modifie pas seulement la physique des flux d’information ; elle réécrit fondamentalement l’économie de l’information », explique Fang. « Lorsque la synthèse devient la principale valeur ajoutée, la création de contenu se banalise tandis que le contrôle de l’interprétation prend de la valeur ». Dès lors qu’une ressource devient librement copiable ou génératrice, sa valeur ne disparaît pas ; elle migre vers ceux qui contrôlent sa distribution et sa synthèse. « On passe ainsi d’un modèle économique de stock à un modèle de flux. Lorsque la musique pouvait être copiée à l’infini et gratuitement, Spotify s’est approprié la valeur en contrôlant l’accès. La réplication de logiciels étant gratuite, le logiciel en tant que service (SaaS) a capté la valeur en contrôlant les mises à jour et l’intégration. L’information a atteint le même point d’inflexion. Lorsque l’IA peut générer un contenu infini à coût marginal nul et lorsque les machines, et non les humains, sont les principaux consommateurs de ce contenu, la valeur ne réside plus dans le contenu lui-même. Elle migre vers l’infrastructure qui contrôle la synthèse : la manière dont l’IA trouve, traite, interprète et diffuse l’information aux humains ».
Dans ce nouveau paradigme économique, tout contenu numérisé devient inévitablement la matière première des infrastructures. La récente vague d’accords entre entreprises d’IA et éditeurs de presse illustre parfaitement cette dynamique. « Il ne s’agit pas simplement de licences de contenu ; ce sont, en fin de compte, des opérations d’infrastructure. Les entreprises d’IA n’achètent pas seulement du contenu ou des données d’entraînement ; elles acquièrent le droit de devenir les canaux légitimes par lesquels transite toute l’information ».
Cette infrastructure de l’intention est déjà en train de se réaliser, explique Fang. Des entreprises comme Pinecone ou Databricks sont en train de construire la couche de recherche qui permet à l’IA de trouver l’information. Tollbit est en train de construire un système de paiement pour le contenu consommé par l’IA, permettant de construire une couche d’attribution permettant de suivre les contributeurs et les rémunérations. Une couche de synthèse contrôle la combinaison des informations, à l’image de LangChain ou du protocole MCP d’Anthropic. Enfin, la couche transactionnelle permet les paiements de machine à machine : Google a récemment annoncé le protocole APP (Agent Payments Protocol), tandis que des solutions crypto promettent une monnaie programmable pour les transactions entre agents.
Mais d’autres couches s’annoncent encore. « Lorsque la mémoire de l’IA deviendra persistante, elle permettra de stocker les préférences des utilisateurs à long terme, et votre « graphe de curiosité » pourrait devenir un actif à la fois malléable et échangeable. Aujourd’hui, les entreprises enchérissent sur les mots-clés que vous avez déjà recherchés. Dans un avenir proche, elles pourraient enchérir pour influencer vos prochaines recherches. Le mécanisme d’enchères publicitaires ne consistera plus à « montrer cette publicité à une personne qui cherche des chaussures », mais à « susciter la curiosité de cette personne pour les chaussures haut de gamme durables avant même qu’elle ne réalise avoir besoin de nouvelles chaussures ». La valeur résidera dans le fait même de susciter cette curiosité. Lorsque l’IA pourra prédire et influencer les désirs avant qu’ils ne se forment, la publicité elle-même pourrait passer de la persuasion à l’anticipation ».
Façonner le désir ?
« De même que les cookies tiers ont engendré toute une économie de données comportementales, les profils de curiosité pourraient être commercialisés et faire l’objet de produits dérivés », s’emballe Fang. « Imaginez des marchés à terme sur les sujets qui intéresseront les personnes fortunées au prochain trimestre, des options sur votre parcours intellectuel, des marchés d’échanges basés sur la corrélation entre vos centres d’intérêt et vos habitudes d’achat. Lorsque les marchés prédictifs synthétisent l’intelligence collective à grande échelle, ils ne se contentent pas de prévoir les événements ; ils peuvent générer des microprofits en anticipant les intentions. Chaque requête devient un pari. Votre assistant IA pourrait littéralement spéculer et potentiellement tirer profit de votre prochaine question, créant ainsi de la liquidité à partir de l’incertitude elle-même. L’écart entre ce que vous pensez vouloir savoir et ce dont vous avez réellement besoin pourrait devenir une inefficience exploitable. Alors, la mémoire et l’intention pourraient donner naissance à quelque chose d’indéfini. Des produits dérivés émotionnels ? Des obligations de curiosité ? ». Certes. Reste que ce monde d’inférences risque surtout d’être assez indifférent à la vérité, ou de pousser les gens vers l’optimisation des prédictions des machines, orientant leurs propos pour vous amener vers les questions qu’elles ont intérêts à produire, par exemple pour maximiser les profits liés à certains mots clés publicitaires sur d’autres. C’est oublier que les systèmes conçus à des fins commerciales ne sont généralement pas destinés à remettre en question vos idées, seulement vous fidéliser.
Shuwei Fang a pourtant raison de s’inquiéter. « Dans ce monde, la vérité de fond, la recherche de la vérité et les mécanismes d’autocorrection de l’information sont plus importants que jamais ». Les journalistes qui conçoivent des systèmes de vérification de nouvelle génération, les spécialistes des technologies civiques qui créent des outils de transparence, les chercheurs qui développent des protocoles de vérification des faits basés sur l’IA, ont tout à fait raison dans leurs convictions. Ce travail est essentiel. Mais il ne suffit pas. L’infrastructure de l’intention façonnera ce qui, au final, parvient aux humains et la manière dont les récits sont synthétisés. « Nous devons commencer à réfléchir à la manière de façonner le prochain écosystème informationnel afin qu’il serve, plutôt qu’il ne compromette, la connaissance et la compréhension humaines ». Mais peut-il encore y avoir une démocratie dans l’économie de l’intention ?
« L’inversion informationnelle émergente signifie que lorsque nous aurons réponse à tout, la curiosité deviendra la dernière rareté ». Dans ce monde, influencer les questions des citoyens pourrait être plus efficace que de contrôler leurs lectures. Les mêmes techniques utilisées par les annonceurs pour anticiper les intentions des consommateurs pourraient déterminer le débat démocratique, et le clore. Un peu comme si les sondages étaient le vote et que ces sondages étaient réalisés sur des profils synthétiques pour finalement se passer de nos opinions.
Reste, estime Fang, que l’infrastructure de curiosité est déjà en train d’être façonnée. Les systèmes capables d’orienter nos demandes sont en train d’être construits. Sans intervention, la technologie qui pourrait aider les citoyens à s’orienter dans la complexité ne fera que confirmer les préjugés. Et la chercheuse d’en appeler à construire des alternatives, avant que les infrastructures soient en place.
« Contrairement aux précédents bouleversements qui ont pris la démocratie au dépourvu (la consolidation des radios, la commercialisation de la télévision, la polarisation des réseaux sociaux), nous pourrions cette fois-ci être avertis ». Pas sûr que cette alerte suffise, hélas, pour éviter les dérives qui nous y conduisent.
MAJ du 05/01/2026 : L’IA générative serait très douée pour influencer les opinions politiques des gens, estime une étude publiée par Nature. « Après avoir discuté avec un bot pro-Trump, une personne sur 35 qui avait initialement déclaré ne pas vouloir voter pour lui a changé d’avis. Le nombre de personnes ayant changé d’avis après avoir discuté avec un bot pro-Harris était encore plus élevé : une sur 21. Un mois plus tard, lors d’un nouveau sondage auprès des participants, cet effet persistait en grande partie. » David Rand, co-auteur de l’étude, ne s’est pas arrêté à l’élection présidentielle américaine. Il a également testé le pouvoir de persuasion des bots d’IA lors d’élections au Canada et en Pologne. Là encore, un participant sur dix a déclaré qu’il changerait d’avis après avoir discuté avec un chatbot. Une étude complémentaire, publiée sur Science, a examiné les facteurs qui rendent un chatbot plus persuasif qu’un autre. Ce n’est pas la puissance des modèles ou la personnalisation qui font la différence. Les chatbots les plus persuasifs sont moins précis mais fournissent plus d’éléments à l’appui de leur argumentation (sans se soucier de leur pertinence).
Bien sûr, les conditions de l’étude sont spécifiques. Les utilisateurs étaient rémunérés pour échanger avec ces chatbots sur leurs choix électoraux. Pour la politologue Jennifer Pan, les méthodes de communication traditionnelles (courrier, appels téléphoniques, publicités télévisées, etc.) sont généralement inefficaces pour influencer les électeurs. Ce n’est pas ce que montre les recherches de David Rand. Recherches dont les perspectives risquent d’aiguiser les appétits.
Pour le journaliste Matteo Wong de The Atlantic, ces débats sur le pouvoir de persuasion des produits d’IA n’est qu’une distraction. « Bien sûr que les chatbots sont conçus pour influencer le comportement humain »… Mais « la véritable manipulation consiste à convaincre des milliards d’utilisateurs que leurs intérêts convergent avec ceux des entreprises technologiques, que l’utilisation d’un chatbot est la meilleure solution à leurs problèmes ».