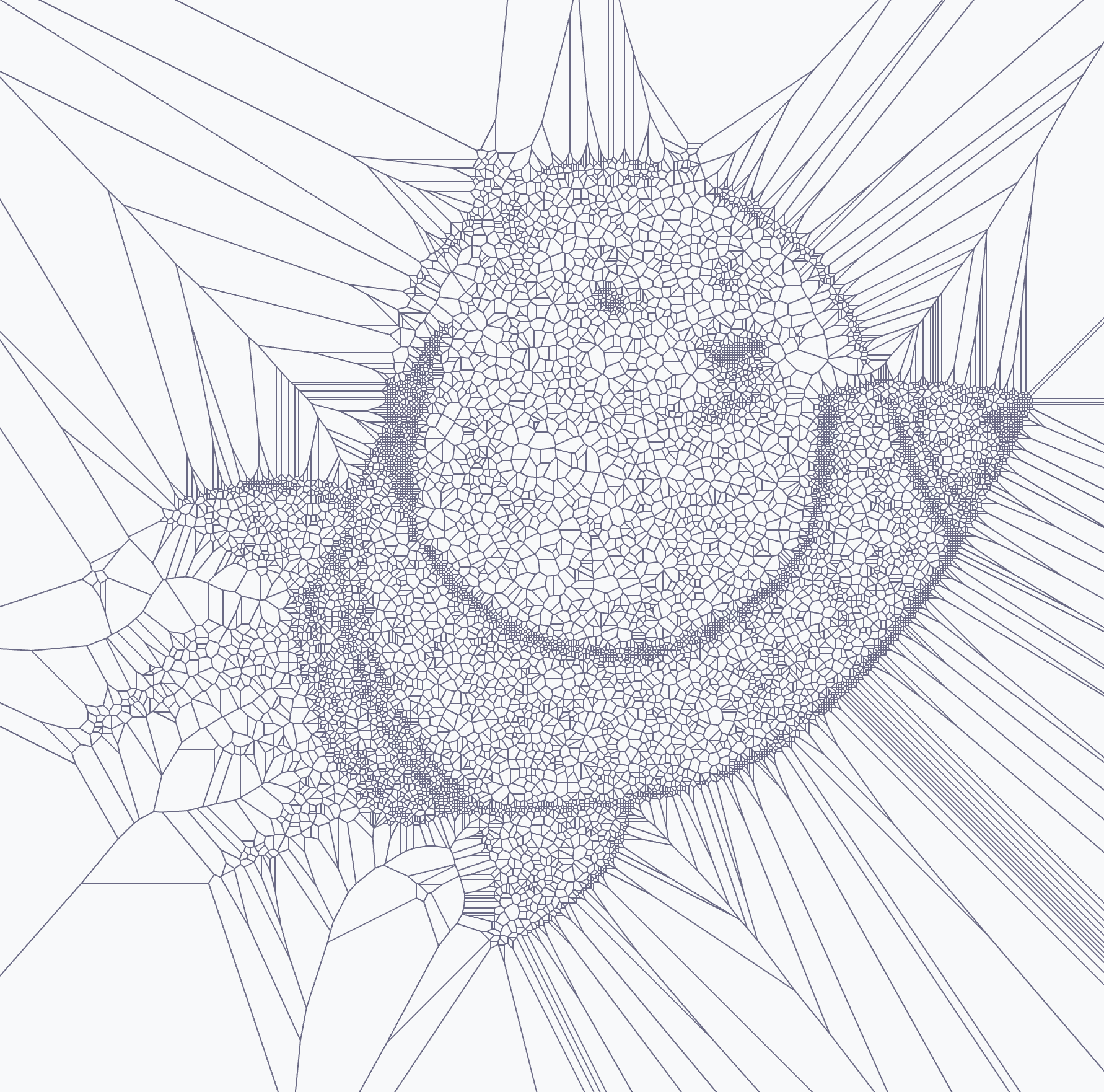Dans la même rubrique
- ↪ Vérification d’âge (3/4) : la panique morale en roue libre
- ↪ Vérification d’âge (2/4) : de l’impunité des géants à la criminalisation des usagers
- ↪ Vérification d’âge (1/4) : vers un internet de moins en moins sûr
- ↪ Syndicats : négociez les algorithmes !
- ↪ Politiques publiques : passer de l’IA… à la dénumérisation
Si le département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) a disparu de l’actualité, ce n’est pas le cas de ses actions ni du modèle initié, au contraire. Aux États-Unis, des dizaines de d’État ont mis en place des « missions d’efficacité », inspirées du Doge. Un point commun à nombre de ces initiatives est « l’objectif affiché d’identifier et d’éliminer les inefficacités des administrations publiques grâce à l’intelligence artificielle (IA) » et de promouvoir « un accès élargi aux systèmes de données étatiques existants », selon une analyse récente de Maddy Dwyer, analyste politique au Centre pour la démocratie et la technologie.
Sur Tech Policy Press, Justin Hendrix en discute justement avec Maddy Dwyer et l’ingénieur Ben Green, dont on a souvent évoqué le travail sur InternetActu et dont on avait lu The smart enough city (MIT Press, 2019, non traduit, voir notre article “Vers des villes politiquement intelligentes”) et qui travaille à un nouveau livre, Algorithmic Realism: Data Science Practices to Promote Social Justice.
Dans son analyse, Maddy Dwyer parle d’une « dogification des administrations américaines » et des gouvernements d’Etats. 29 États américains ont mis en place des initiatives en ce sens, avec des succès pour l’instant mitigés, et un certain nombre (11) ont particulièrement mobilisé les données et l’IA pour se faire. Certains l’ont mobilisé pour simplifier les processus réglementaires, réduire les effectifs et évaluer les financements. Dwyer a établi 5 signaux d’alertes permettant de montrer que ces dogifications pouvaient être problématiques.
La première concerne le manque de transparence. Du Doge fédéral à ses déclinaisons locales, dans beaucoup de situations nous ne savons pas qui compose la structure, quel est son rôle, quelles sont ses attributions légales, de quels accès aux systèmes dispose-t-il ?
Le second point d’alerte concerne les violations des règles sur la protection de la vie privée, notamment lorsque le Doge a eu accès à des données sensibles et protégées. Cela rappelle aux Etats qu’ils ont l’obligation de veiller à ce que leurs initiatives d’efficacité soient conformes aux lois sur la confidentialité et la cybersécurité.
Le troisième point d’alerte concerne les failles de sécurité et notamment l’absence de contrôle d’accès, voir l’usurpation d’identité. L’efficacité ne peut se faire au détriment de la sécurité des systèmes.
Le quatrième signal d’alarme concerne l’instrumentalisation des données gouvernementales, notamment en accélérant les échanges de données entre agences, à des fins non prévues initialement et au risque de saper la confiance des administrés.
Enfin, un ultime signal d’alarme consiste à utiliser des outils IA sans avoir démontré leur efficacité pour prendre des décisions à haut risque. Les administrations et États locaux devraient donc s’assurer que les outils utilisés sont bien adaptés aux tâches à accomplir.
Pour Ben Green, ces programmes sont d’abord des programmes austéritaires. Le Doge nous a surtout montré qu’intégrer la technologie dans l’administration peut considérablement échouer. Certes l’IA peut produire du code, mais une grande partie du travail d’ingénieur logiciel ne consiste pas à l’écrire, il consiste à l’intégrer dans un système logiciel complexe, de suivre des protocoles de sécurité appropriés, de concevoir un logiciel capable d’être maintenu dans le temps. Autant de choses que les outils de codage automatisés savent peu faire, rappelle l’ingénieur. Ensuite, ce n’est pas parce qu’un outil d’IA a des capacités ou semble utile qu’il est réellement utile aux travailleurs d’un domaine très spécifique. Déployer un chatbot pour les agents fédéraux ne leur est pas très utile, comme l’expliquait Wired. Un outil d’IA ne sait pas s’intégrer dans un contexte de règles, de réglementations, de processus ni vraiment avec d’autres équipes avec lesquelles les administrations se coordonnent. En vérité, rappelle Green, « il est extrêmement difficile de faire collaborer efficacement les gens et l’IA ». Pour lui, le succès de l’IA s’explique parce qu’elle « rend la mise en œuvre des mesures d’austérité plus rapides ». L’IA est un prétexte, comme le disait Eryk Salvaggio. Elle n’améliore pas l’efficacité du gouvernement. Quand l’IA a été mobilisée au sein de l’Agence des anciens combattants pour réduire les contrats, le code pour distinguer les contrats acceptables des autres a été écrit en une seule journée. Pour Green, le Doge ne s’est jamais soucié de bien faire les choses, ni de garantir le bon fonctionnement des systèmes, mais simplement de rapidité. Sans compter, rappelle Maddy Dwyer, que les administrations subissent désormais une forte pression à avoir recours à l’IA.
Pour Justin Hendrix, nous sommes aujourd’hui dans un cycle technologique et politique d’expansion de l’IA. Mais ce cycle risque demain de passer. Pourra-t-on utiliser l’IA autrement ? Il est probable que administrations fédérales, étatiques ou locales, se rendent compte que l’IA ne leur apporte pas grande chose et génère surtout des erreurs et de l’opacité, tout comme les entreprises elles-mêmes commencent à déchanter. C’était d’ailleurs l’un des constats du rapport sur l’état du business des l’IA générative publiée par le MIT, qu’évoquait Fortune fin août : « 95% des projets pilotes d’IA générative dans les entreprises échouent ». L’intégration d’outils IA dans les entreprises se révèle particulièrement ardue, et les projets sont souvent peu pertinents, bien moins que les outils des grands acteurs de l’IA. Le rapport soulignait également un décalage dans l’allocation des ressources : plus de la moitié des budgets dédiés à l’IA génératives sont orientés vers le marketing et la vente plutôt que vers l’automatisation des processus métiers. Dans le New York Times, Steve Lohr résumait autrement la situation. « Selon une étude récente de McKinsey & Company, près de huit entreprises sur dix déclarent utiliser l’IA générative, mais tout aussi nombreuses sont celles qui n’ont signalé aucun impact significatif sur leurs résultats financiers. » Malgré l’espoir d’une révolution dans tous les domaines, de la comptabilité back-office au service client, les bénéfices des entreprises à adopter l’IA peinent à émerger. C’est « le paradoxe de l’IA générative », comme dit McKinsey. Et il ressemble furieusement au paradoxe de la productivité de l’introduction des premiers ordinateurs personnels dans les entreprises : malgré les investissements massifs des entreprises dans l’équipement et les nouvelles technologies, les économistes voyaient peu de gains de productivité chez les employés. Selon une enquête de S&P Global, 42% des entreprises qui avaient un projet pilote d’AI l’ont abandonné en 2024, contre 17% l’année précédente. Pour le Gartner, qui analyse depuis des années les cycles de battage médiatique technologiques, l’IA est en train de glisser vers le creux de la désillusion, tout en promettant que c’est l’étape avant qu’une technologie ne devienne un outil à la productivité éprouvé (oubliant de rappeler pourtant, que nombre de technologies mise en avant par cette étude annuelle controversée et fort peu sérieuse, ne sont jamais revenues du creux de la désillusion). Pour l’instant, rappelle Lohr, les seuls gagnants de la course à l’IA ont été les fournisseurs de technologies et de conseils en IA, même si le journaliste tente de nous convaincre du contraire en nous parlant du déploiement de systèmes d’IA chez deux acteurs mondiaux, sans qu’ils soient encore capables de mesurer leurs effets. « Il n’est pas surprenant que les premiers efforts en matière d’IA échouent », clamait Andrew McAfee, codirecteur de l’Initiative sur l’économie numérique du Massachusetts Institute of Technology et fondateur de Workhelix, une société de conseil en IA : « L’innovation est un processus d’échec assez régulier. »
Reste qu’il est difficile de changer de cap pour ceux qui l’adoptent, rappelle Green, alors que ces bascules favorisent une approche très solutionniste de la technologie. Dans les technologies liées à la ville intelligente, l’adoption rapide de technologies a été déceptive et a conduit à l’abandon de nombre de projets, parce que les équipes, face aux critiques, sont souvent désarmées. Pour lui, l’idée d’une IA indispensable risque surtout de rendre le réveil difficile. « Pour beaucoup de personnes travaillant dans le domaine de la technologie et du gouvernement, la technologie devient la finalité, et on perd de vue ce que nous cherchons réellement à accomplir. On se laisse alors happer par des idées très étroites d’efficacité », au détriment de l’amélioration du gouvernement. Notre navigation à courte vue entre des programmes très pro-techno et leur reflux, conduit à bien plus de stagnation que d’avancées.
Pour Maddy Dwyer tout l’enjeu vise à évaluer s’il existe des alternatives à l’IA plus adaptées pour résoudre nos problèmes, en favorisant la transparence des solutions. Pour Ben Green, nous devrions chercher à mieux comprendre pourquoi l’IA suscite un tel engouement et comment il se propage.
L’engouement pour les solutions technologiques ne date pas de l’IA, comme le montre les nombreuses vagues que nous avons connues. Pour Green, l’enjeu ne consiste pas seulement à expliquer pourquoi l’IA est défaillante, mais à comprendre pourquoi « notre façon de concevoir la technologie est défaillante ». Nous devrions réfléchir à « la façon dont l’information sur la technologie est transmise et partagée à des personnes qui souhaitent simplement améliorer le gouvernement et croient que toutes ces technologies sont efficaces pour y parvenir ». Enfin, dans les discours actuels sur l’efficacité, il faut prendre en compte l’austérité bien sûr, mais plus encore mieux mesurer la profonde méfiance qui s’exprime à l’égard des fonctionnaires. Pourquoi « ne fait-on pas confiance aux bureaucrates pour prendre des décisions à notre place » ? Si l’efficacité est importante, la gauche devrait aussi porter un discours sur l’intérêt général, la dignité, le bien être. L’efficacité est un piège qu’il faut à la fois répondre et dépasser.
Hubert Guillaud
MAJ du 30/12/2025 : Un excellent article de Ben Green sur le Doge et ses limites, revient sur l’arrogance des ingénieurs. Les tentatives pour intégrer l’IA pour détecter la fraude ont souvent conduit à des naufrages. “Dans le Michigan, l’Agence d’assurance chômage (UIA) a adopté un algorithme (le Michigan Integrated Data Automated System, ou MiDAS) pour rationaliser ses opérations. L’UIA visait à prévenir la fraude au chômage et à supprimer un tiers de ses effectifs en automatisant les tâches administratives. MiDAS a rapidement multiplié par cinq le nombre de cas présumés de fraude aux prestations sociales, ce qui a multiplié par 23 les recettes de l’UIA”. Le problème, c’est que ces accusations de fraude – 93 % des cas présumés – étaient erronées. Il a fallu des années de procédure pour que les personnes accusées à tort obtiennent les sommes qui leur étaient dues et pour beaucoup, l’accusation de fraude est restée inscrite à leur casier judiciaire pendant des années.
“L’une des principales raisons de ces dysfonctionnements de l’IA est que les ingénieurs sous-estiment la complexité des processus gouvernementaux. Par conséquent, ils intègrent leurs hypothèses superficielles dans les logiciels et surestiment les capacités de leurs outils.”
Le Doge n’a cessé de porter de nombreux jugements infondés sur le gaspillage et la fraude, basés sur les résultats de l’IA. Le problème, rappelle Green, c’est que les développeurs sont souvent “plus soucieux d’éviter les faux négatifs (le fait de passer à côté d’un cas de fraude) que les faux positifs (le fait de qualifier à tort un contrat de gaspillage ou de frauduleux)”.
L’une des causes d’accusations erronées réside dans une mauvaise interprétation des informations contenues dans les bases de données gouvernementales, notamment parce que les comprendre nécessite d’en comprendre les couches. Musk par exemple s’est indigné que des millions de personnes de plus de 100 ans aient reçu des allocations.. Alors qu’en fait, elles ne reçoivent pas d’allocations et surtout, si elles sont considérées comme vivantes, alors qu’elles ne le sont pas, c’est parce que l’administration n’a pas procédé à une mise à jour coûteuse de son système. Si Musk avait consulté les experts, il aurait pu le comprendre. Au lieu de cela, il a tweeté une information erronée… avec la plus grande assurance.