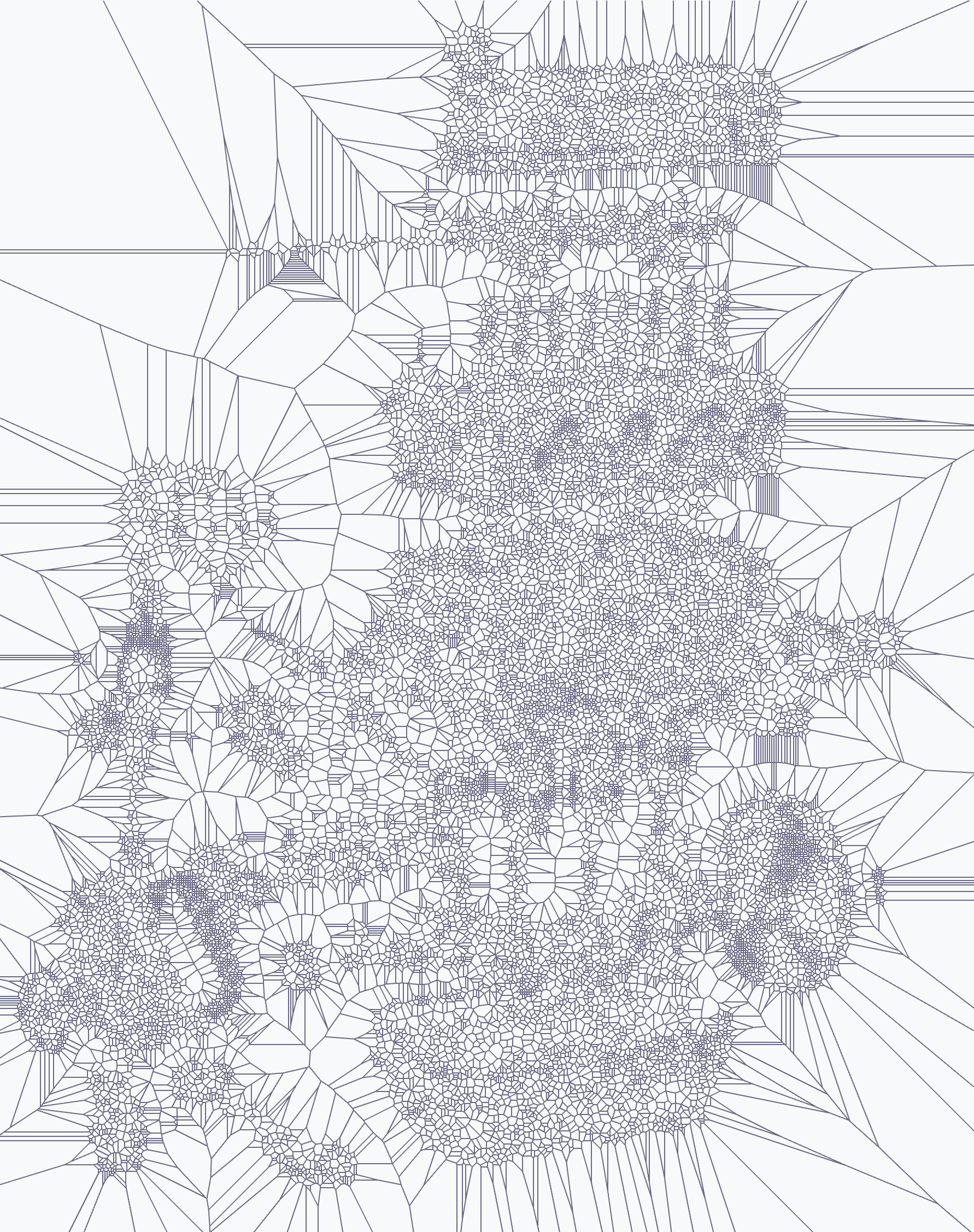Dans la même rubrique
On se souvient, avec entrain, des 19 petits Exercices d’observations (Premier Parallèle, 2022) de Nicolas Nova : invitations à nous jouer du monde, à aiguiser nos capacités d’observations en apprenant à décaler son regard sur le monde qui nous entoure. Matthieu Raffard et Mathilde Roussel les mettent en pratique et les prolongent, dans A contre-emploi : manuel expérimental pour réveiller notre curiosité technologique (Premier Parallèle, 2025). Les deux artistes et enseignants-chercheurs nous invitent à nous intéresser aux objets techniques qui nous entourent, à les observer pour nous libérer de leur autorité. Ces 11 nouveaux exercices d’observation active nous montrent que comprendre la technique nécessite, plus que jamais, de chercher à l’observer autrement que la manière dont elle nous est présentée.
A contre-emploi commence par un moulin à café qui tombe en panne et continue en explorant des machines qui dysfonctionnent… Dans ce monde à réparer, nous avons « à remettre du je » dans le lien que nous entretenons avec les machines. Que ce soit en explorant les controverses situées des trottinettes en libre accès ou les rapports difficiles que nous avons à nos imprimantes, les deux artistes nous invitent au glanage pour ré-armer notre sensibilité technique. Ils nous invitent à ré-observer notre rapport aux objets techniques, pour mieux le caractériser, en s’inspirant des travaux d’observations typologiques réalisés par Bernd et Hilla Becher ou par Marianne Wex par exemple. Pour Raffard et Roussel, à la suite des travaux du psychologue James Gibson dans Approche écologique de la perception visuelle (1979, éditions du Dehors, 2014), c’est en se déplaçant dans notre environnement visuel qu’on peut voir émerger d’autres catégories. C’est le mouvement qui nous permet de voir autrement, rappellent-ils Pour les deux artistes : « c’est la fixité de notre position d’observateur qui rend notre lecture des environnements technologiques compliquée ».
Pour changer de regard sur la technologie, nous avons besoin d’une « nouvelle écologie de la perception ». Pour cela, ils nous invitent donc à démonter nos objets pour mieux les comprendre, pour mieux les cartographier, pour mieux saisir les choix socio-économiques qui y sont inscrits et déplacer ainsi leur cadre symbolique. Ils nous invitent également à lire ce qu’on y trouve, comme les inscriptions écrites sur les circuits électroniques, d’une manière quasi-automatique, comme quand Kenneth Goldsmith avait recopié un exemplaire du New York Times pour mieux se sentir concerné par tout ce qui y était inscrit – voir notre lecture de L’écriture sans écriture (Jean Boîte éditions, 2018). Raffard et Roussel rappellent que jusqu’en 1970, jusqu’à ce qu’Intel mette au point le processeur 4004, tout le monde pouvait réencoder une puce électronique, comme l’explique le théoricien des médias Friedrich Kittler dans Mode protégé (Presses du réel, 2015). Cet accès a été refermé depuis, nous plongeant dans le « paradoxe de l’accessibilité » qui veut que « plus un objet devient universel et limpide en surface, plus il devient opaque et hermétique en profondeur. Autrement dit, ce que l’on gagne en confort d’expérience, on le perd en capacité de compréhension – et d’action ». Pour le géographe Nigel Thrift, nos objets technologiques nous empêchent d’avoir pleinement conscience de leur réalité. Et c’est dans cet « inconscient technologique », comme il l’appelait, que les forces économiques prennent l’ascendant sur nos choix. « Dans les sociétés technocapitalistes, nous sommes lus davantage que nous ne pouvons lire ».
Ils nous invitent à extraire les mécanismes que les objets assemblent, comme nous y invitait déjà le philosophe Gilbert Simondon quand il évoquait l’assemblage de « schèmes techniques », c’est-à-dire l’assemblage de mécanismes existants permettant de produire des machines toujours plus complexes. Ils nous invitent bien sûr à représenter et schématiser les artefacts à l’image des vues éclatées, diffractées que proposent les dessins techniques, tout en constatant que la complexité technologique les a fait disparaître. On pense bien sûr au travail de Kate Crawford (Anatomy of AI, Calculating Empires) et son « geste stratégique », ou établir une carte permet de se réapproprier le monde. On pense également au Handbook of Tyranny (Lars Müller Publishers, 2018) de l’architecte Theo Deutinger ou les topographies de pouvoir de l’artiste Mark Lombardi ou encore au Stack (UGA éditions, 2019) du designer Benjamin Bratton qui nous aident à visualiser et donc à comprendre la complexité à laquelle nous sommes confrontés. La cartographie aide à produire des représentations qui permettent de comprendre les points faibles des technologies, plaident les artistes. Elle nous aide à comprendre comment les technologies peuvent être neutralisées, comme quand Extinction Rébellion a proposé de neutraliser les trottinettes électriques urbaines en barrant à l’aide d’un marqueur indélébile, les QR codes pour les rendre inutilisables. Ces formes de neutralisations, comme on les trouve dans le travail de Simon Weckert et son hack de Google Maps en 2020, permettent de faire dérailler la machine, de trouver ses faiblesses, de contourner leur emprise, de « s’immiscer dans l’espace que contrôlent les technologies », de contourner ou détourner leurs assignations, de détourner leurs usages, c’est-à-dire de nous extraire nous-mêmes des scénarios d’usages dans lesquels les objets technologiques nous enferment, c’est-à-dire de réécrire les « scripts normatifs » que les technologies, par leur pouvoir, nous assignent, de comprendre leur « toxicité relationnelle ».
Ils nous invitent enfin à construire nos machines, bien plus modestement qu’elles n’existent, bien sûr. Les machines que nous sommes capables de refaçonner, seuls, ne peuvent répondre à la toute-puissance des technologies modernes, rappellent-ils en évoquant leur tentative de reconstruire une imprimante à jet d’encre. Raffard et Roussel ont reconstruit une imprimante encombrante et peu performante, tout comme Thomas Thwaites avait reconstruit un grille-pain défaillant (The Toaster Project, Princeton, 2011). Cette bricologie a néanmoins des vertus, rappellent les artistes. Elle nous rappelle qu’à la toute puissance répond la vulnérabilité, à la high tech, la low tech. Et que ce changement même de regard, cette réappropriation, permet au moins de modifier le système cognitif des utilisateurs. Comme quand les manifestes cyberféministes nous invitent à regarder le monde autrement (souvenez-vous de Data Feminism). Pour Raffard et Roussel, créer des situations de vulnérabilité permet de changer la relation que nous avons avec les objets techniques. De nous réinterroger, pour savoir si nous sommes satisfaits de la direction dans laquelle les objets technologiques et nous-mêmes évoluons. En nous invitant à décider de ce que nous voulons faire de nos technologies et de ce que nous acceptons qu’elles nous fassent, ils militent pour une éducation à l’expérimentation technologique, qui fait peut-être la part un peu trop belle à notre rapport aux technologies, plutôt qu’à notre liberté à ne pas s’y intéresser.
Le manuel pour réveiller notre curiosité technologique oublie peut-être que nous aurions aussi envie de les éteindre, de nous en détourner, de nous y opposer. Car le constat qu’ils dressent, à savoir celui que nous ne sommes pas capables de reproduire la puissance des machines contemporaines par nous-mêmes, risque d’être perçu comme un aveu d’impuissance. C’est peut-être là, la grande limite au démontage qu’ils proposent. Renforcer notre impuissance, plutôt que de nous aider à prendre le contrôle des systèmes, à peser de nos moyens d’actions collectifs contre eux, comme le peuvent la démocratie technique et la législation. Nous pouvons aussi parfois vouloir que la technologie ne nous saisisse pas… Et prendre le contrôle des systèmes pour que cela n’arrive pas, les réguler, nous y opposer, refuser de les comprendre, de les faire entrer là où nous ne voulons pas qu’ils interviennent est aussi un levier pour nous saisir des objets qui s’imposent autour de nous.
Hubert Guillaud
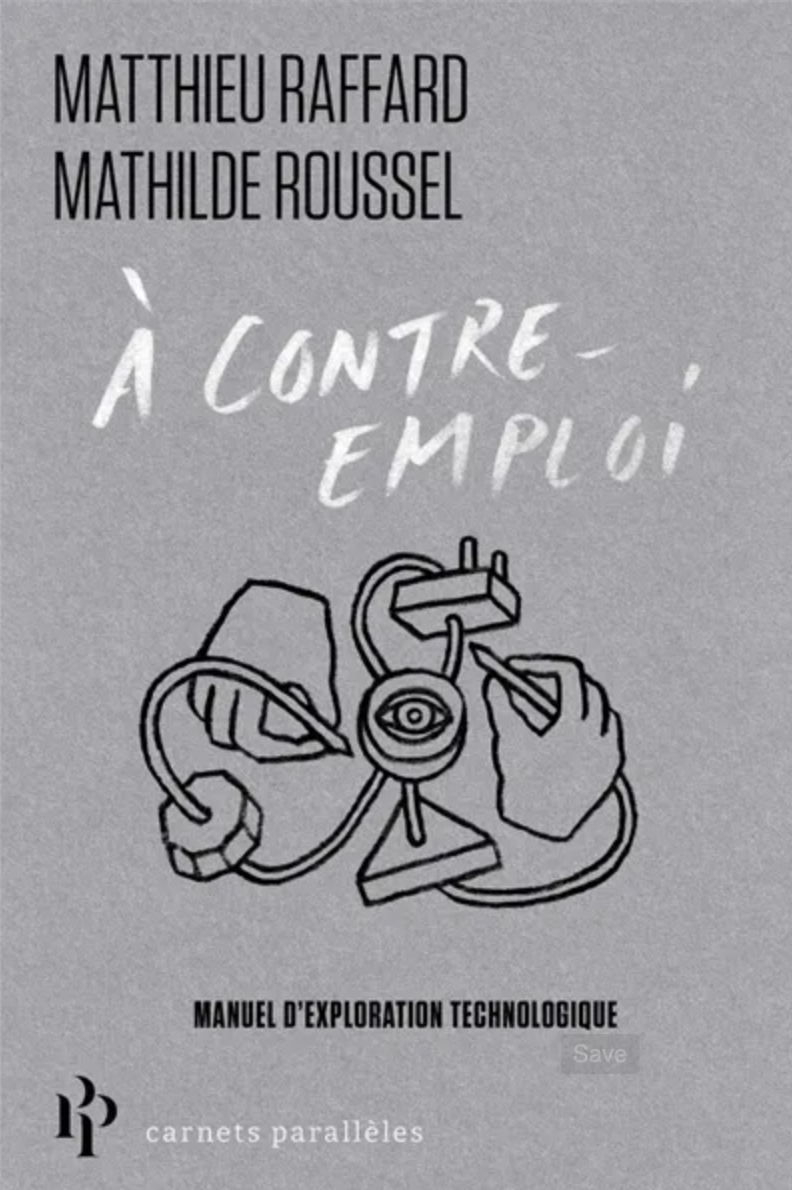
MAJ du 7/11/2025 : Signalons que Matthieu Raffard et Mathilde Roussel publient un autre livre, directement issu de leur thèse, Bourrage papier : leçons politiques d’une imprimante (Les liens qui libèrent, 2025).