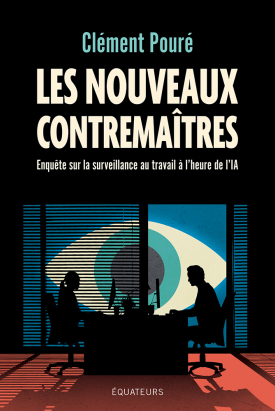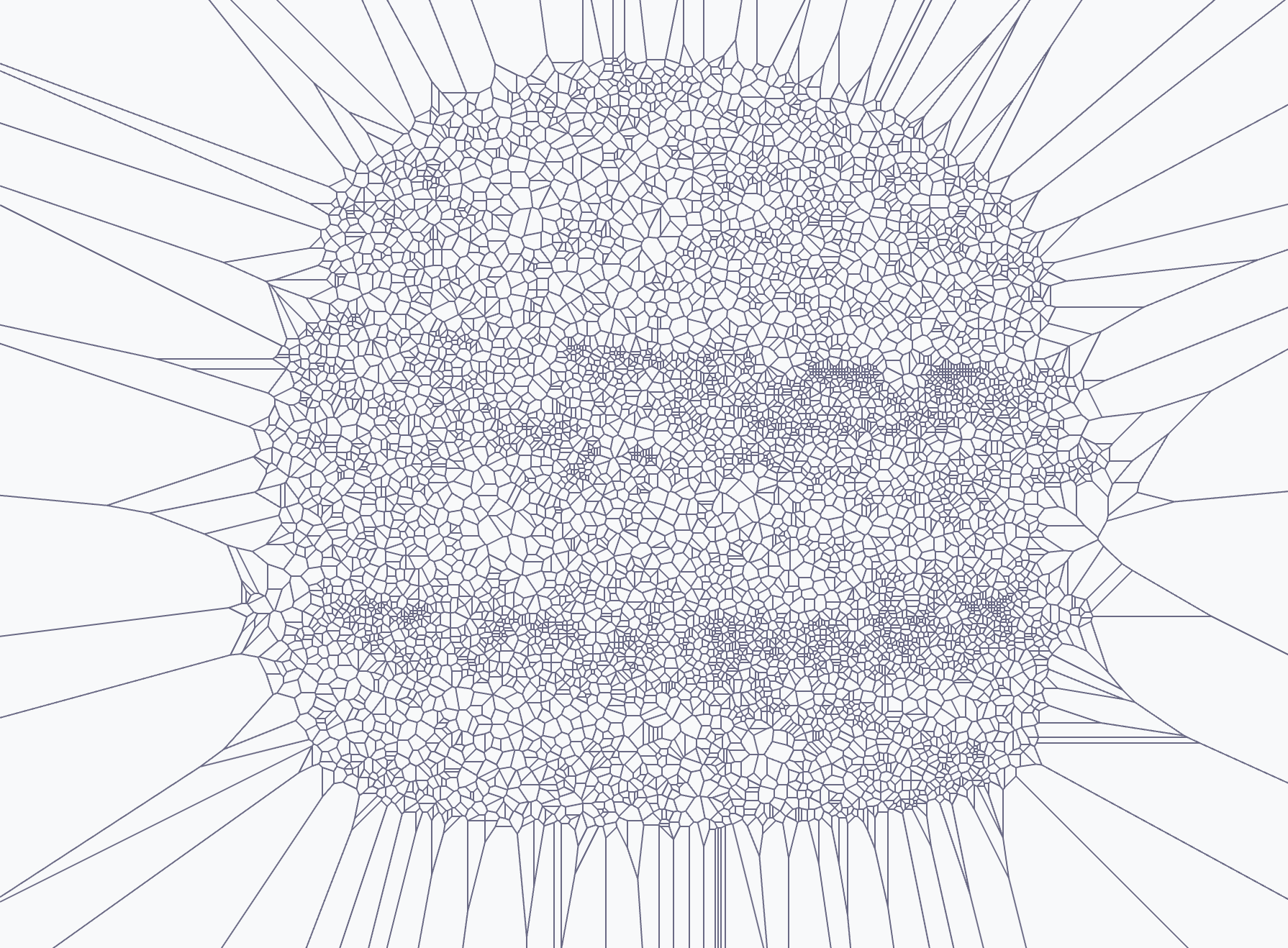Le journaliste indépendant Clément Pouré, dont on a lu bien des articles sur sur Mediapart, notamment… signe Les nouveaux contremaîtres : enquête sur la surveillance au travail à l’heure de l’IA (Equateurs, 2025).
Dans DLA, nous avons souvent documenté l’enjeu de surveillance que produit le développement du numérique sur le travail : son emprise coercitive qui vient contraindre les activités et augmenter les cadences. Clément Pouré prolonge ce regard depuis une enquête qui mêle terrain et prise de distance. Son livre donne la part belle aux témoignages de personnes confrontées à la réalité du contrôle au travail. Pouré tente de nous montrer, partout où elle a lieu et comment elle procède. Du minutage du temps de réalisation des Big Mac au minutage des durées d’intervention des réparateurs ou des employés des centres d’appels, de la surveillance des activités des développeurs sur Github au contrôle des employés en télétravail… Partout, les machines resserrent leur emprise sur les travailleurs. Partout, la même logique est à l’œuvre.
En évoquant, les difficultés des conditions de travail dans la logistique (voir notre article, « L’ogre logistique »), le sociologue David Gaborieau y distingue le contrôle de la surveillance. Le contrôle prescrit et organise le travail, impose des modalités normées, quand la surveillance, elle observe la productivité et le comportement des travailleurs. Dans certains secteurs, comme la logistique, « le contrôle est tellement fort que la surveillance est plutôt rare », rappelle-t-il. « La machine met la pression toute seule », témoigne un salarié de McDo : chaque sandwich doit sortir en 300 secondes. Là où le contrôle est difficile, parce que les gestes pour réaliser le travail sont peu scriptés, la surveillance prend le relais et inversement. Et leur développement s’entremêle pour laisser de moins en moins de marge de manœuvre à tous.
Les progiciels de travail sont désormais partout. Rares sont les secteurs qui y échappent. Le développement des systèmes de contrôle au travail dévalorise le travail et dégrade les conditions de travail, comme le soulignait le sociologue Juan Sebastian Carbonell dans son récent livre. Ils servent à enlever du pouvoir aux employés qualifiés pour le donner aux ingénieurs, à ceux qui programment machines et logiciels, moins nombreux et plus dociles. L’automatisation permet surtout de « reléguer la prise de décision à des systèmes, et avec eux aux cadres, transformant les employés en simples exécutants ». Avec eux, bien souvent, les employés deviennent plus facilement remplaçables, les rémunérations moins élevées et les horaires plus irréguliers. Les systèmes imposent les cadences au détriment de la santé. Qu’importe si la course à la productivité pèse d’abord sur les cotisations sociales de chacun, puisque les corps abîmés sont bien plus pris en charge par la société que par les entreprises. Qu’importe si cela se fait au coût d’un turnover conséquent. Les objectifs de productivité sont individualisés. Les productions comme les ventes sont mesurées à l’heure, pour chacun. Tout l’enjeu est désormais de régler la machine pour optimiser la productivité, ajuster les indicateurs… « sans que ça explose ».
Dans nombre d’entreprises, raconte Pouré, les choses se dégradent souvent par l’introduction de la surveillance. On commence par introduire des badges et des caméras. La défiance s’installe toujours au prétexte d’améliorer la sécurité. Pourtant, comme le rappellent nombre de scandales liés à la vidéosurveillance en entreprise, « le management essaie régulièrement de détourner les caméras pour s’en servir contre les salariés », comme ce fut le cas chez Basic-Fit. « Aucune enquête sérieuse ne s’intéresse à l’utilisation concrète des caméras de surveillance au travail », rappelle celui qui a beaucoup enquêté sur le sujet. Pourtant, elles sont extrêmement mobilisées pour surveiller les salariés, comme dans le monde de la coiffure ou dans les salles d’escalades.
En caisse, les codes-barres permettent de passer à des cadences industrielles. Là encore, dans la grande distribution, on mesure le nombre d’articles scannés à la minute (29 à 32). Là aussi le turnover est fort. Dans les données, la complexité du travail est simplifiée. Tout ce qui n’est pas rentable disparaît, même si cela permet de fidéliser la clientèle, l’image de marque ou des revenus à long terme.
De l’autre côté du spectre, les entreprises qui font parler les données des points de vente ou de la production se portent bien. Elles raffinent les données, les analysent pour trouver des optimisations nouvelles. La performance de chaque employé est observée à la loupe. Les employés sont comparés entre eux quels que soient les secteurs où ils travaillent. Partout, leur nombre est optimisé aux objectifs productifs du site, de plus en plus finement.
Dans les centres d’appels de Téléperformance, les employés qui restent changent de postes et de sites pour éviter qu’ils ne puissent s’organiser – quand ils ne sont pas transformés en simple télétravailleurs pour être plus isolés encore. Les erreurs et les problèmes sont listés. Les employés doivent en rendre compte selon des entretiens tout aussi codifiés que les procédures de travail. Ici, tout est sous contrôle, comme le disait le journaliste dans son enquête pour Mediapart. Et ces logiciels ne surveillent pas seulement les ouvriers, leurs regards s’étendent de plus en plus aux cadres, comme c’est le cas des développeurs, monitorés à la ligne de code sur GitHub.
Bien des indicateurs finissent par être écrasants, ne parvenant à mesurer que ce qu’ils mesurent. On compte le nombre d’interventions, pas leur complexité. On compte la rentabilité, pas l’expérience nécessaire pour y parvenir.
Le pouvoir est un script disaient Hadjadji et Tesquet. Clément Pouré en montre les réalités. Il nous montre la réalité du bossware, en descendant dans les logiciels développés par Hubstaff, Time Doctor, FlexiSPy, CleverControl… capables de montrer l’activité d’un employé sur son ordinateur dans le plus total détail. Celle-ci s’étend très souvent aux réseaux sociaux où les propos des employés sont de plus en plus évoqués dans des entretiens préalables au licenciement. D’un outil l’autre, la plateformisation du travail progresse. Et l’IA ne va rien améliorer. « Les biais, au fond, n’existent pas. Les discriminations relèvent du fonctionnement naturel de l’IA », constate, désabusé, le journaliste. Dans la banque, les conseillers n’ont plus comme fonction que de valider des contenus standardisés et sont de plus en plus dédiés à des objectifs commerciaux. Leur travail consiste à passer un certain nombre d’appels par jours et à répondre à encore plus de mails. L’efficacité est mesurée, qu’importe les difficultés des clients… Dans certaines banques, le nombre de conseillers n’est que de quelques milliers pour gérer des millions de clients.
Derrière la manière dont les nouveaux contremaîtres numériques s’en prennent aux employés, il faut saisir que ces contremaîtres eux-mêmes sont une ligne une ligne budgétaire à optimiser. Comme on l’a vu dans le service client ou dans la modération chez Meta. Le travail est en passe de devenir partout une optimisation à flux tendu, sans aucune marge de manœuvre.
La comptabilité a pris le pouvoir, la machine à profit tourne pour elle-même. Les conséquences concrètes, elles, n’entrent plus en ligne de compte. « Le numérique commande, le numérique surveille, le numérique punit », nous disait déjà Karen Levy. Clément Pouré nous montre que ce numérique là est en passe de s’immiscer partout dans le monde du travail, sans échappatoire.
Hubert Guillaud