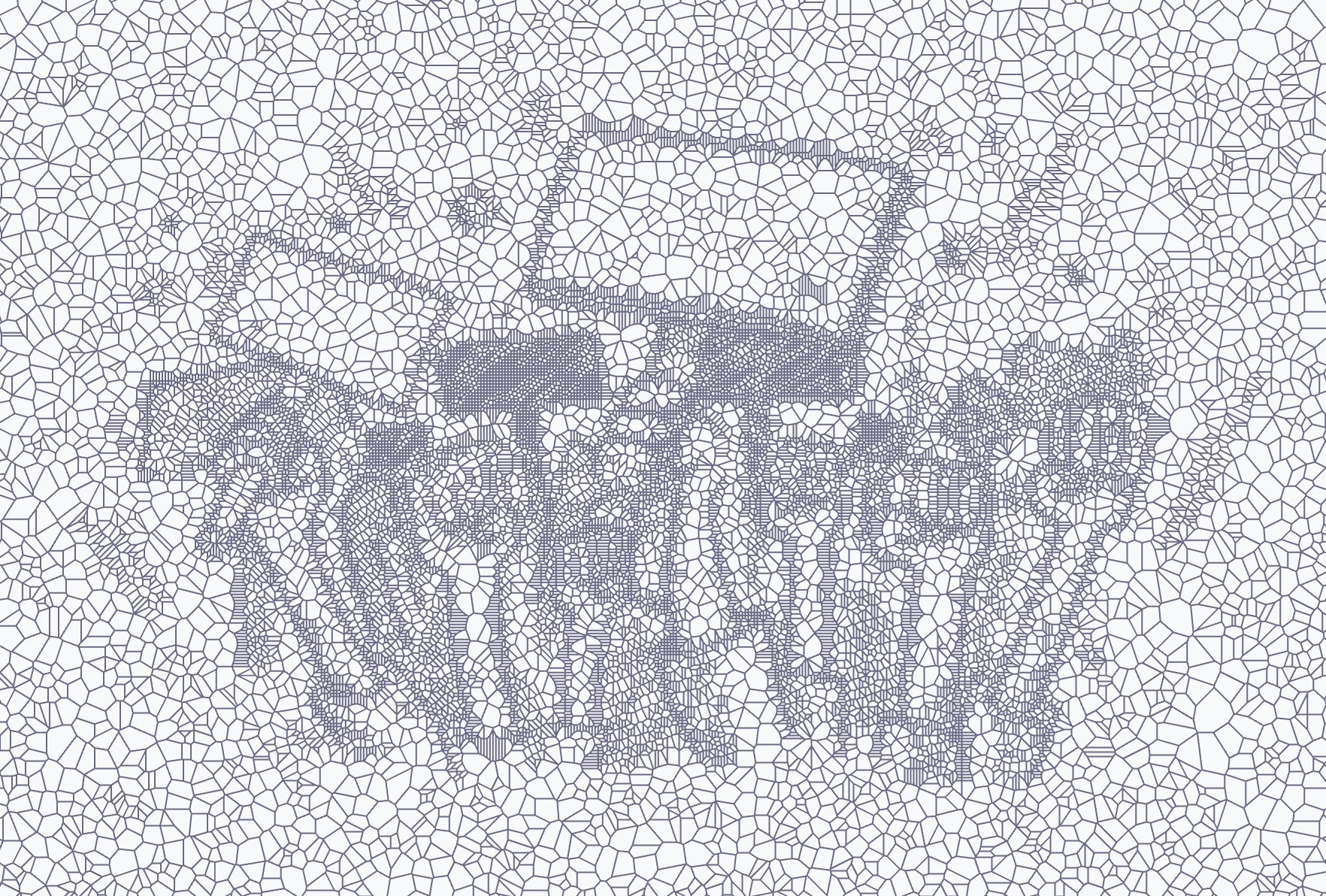La politologue Erica Chenoweth est la directrice du Non Violent Action Lab à Harvard. Elle a publié de nombreux livres pour montrer que la résistance non violente avait des effets, notamment, en français Pouvoir de la non-violence : pourquoi la résistance civile est efficace (Calmann Levy, 2021). Mais ce n’est plus le constat qu’elle dresse. Elle prépare d’ailleurs un nouveau livre, The End of People Power, qui pointe le déclin déroutant des mouvements de résistance civile au cours de la dernière décennie, alors même que ces techniques sont devenues très populaires dans le monde entier. Lors d’une récente conférence sur l’IA et les libertés démocratiques organisée par le Knight First Amendment Institute de l’université de Columbia, elle se demandait si l’IA pouvait soutenir les revendications démocratiques, rapporte Tech Policy Press (vidéo). L’occasion de rendre compte à notre tour d’un point de vue décoiffant qui interroge en profondeur notre rapport à la démocratie.
La récession démocratique est engagée
La démocratie est en déclin, explique Erica Chenoweth. Dans son rapport annuel, l’association internationale Freedom House parle même de “récession démocratique” et estime que la sauvegarde des droits démocratiques est partout en crise. 2025 pourrait être la première année, depuis longtemps, où la majorité de la population mondiale vit sous des formes de gouvernement autoritaires plutôt que démocratiques. Ce recul est dû à la fois au développement de l’autoritarisme dans les régimes autocratiques et à l’avancée de l’autocratie dans les démocraties établies, explique Chenoweth. Les avancées démocratiques des 100 dernières années ont été nombreuses et assez générales. Elles ont d’abord été le fait de mouvements non violents, populaires, où des citoyens ordinaires ont utilisé les manifestations et les grèves, bien plus que les insurrections armées, pour déployer la démocratie là où elle était empêchée. Mais ces succès sont en déclin. Les taux de réussite des mouvements populaires pacifistes comme armés, se sont effondrés, notamment au cours des dix dernières années. “Il y a quelque chose de global et de systémique qui touche toutes les formes de mobilisation de masse. Ce n’est pas seulement que les manifestations pacifiques sont inefficaces, mais que, de fait, les opposants à ces mouvements sont devenus plus efficaces pour les vaincre en général”.
Les épisodes de contestation réformistes (qui ne relèvent pas de revendications maximalistes, comme les mouvements démocratiques), comprenant les campagnes pour les salaires et le travail, les mouvements environnementaux, les mouvements pour la justice raciale, l’expansion des droits civiques, les droits des femmes… n’ont cessé de subir des revers et des défaites au cours des deux dernières décennies, et ont même diminué leur capacité à obtenir des concessions significatives, à l’image de la contestation de la réforme des retraites en France ou des mouvements écologiques, plus écrasés que jamais. Et ce alors que ces techniques de mobilisation sont plus utilisées que jamais.
Selon la littérature, ce qui permet aux mouvements populaires de réussir repose sur une participation large et diversifiée, c’est-à-dire transversale à l’ensemble de la société, transcendant les clivages raciaux, les clivages de classe, les clivages urbains-ruraux, les clivages partisans… Et notamment quand ils suscitent le soutien de personnes très différentes les unes des autres. “Le principal défi pour les mouvements de masse qui réclament un changement pour étendre la démocratie consiste bien souvent à disloquer les piliers des soutiens autocratiques comme l’armée ou les fonctionnaires. L’enjeu, pour les mouvements démocratiques, consiste à retourner la répression à l’encontre de la population en la dénonçant pour modifier l’opinion générale ». Enfin, les mouvements qui réussissent enchaînent bien souvent les tactiques plutôt que de reposer sur une technique d’opposition unique, afin de démultiplier les formes de pression.
La répression s’est mise à niveau
Mais l’autocratie a appris de ses erreurs. Elle a adapté en retour ses tactiques pour saper les quatre voies par lesquelles les mouvements démocratiques l’emportent. “La première consiste à s’assurer que personne ne fasse défection. La deuxième consiste à dominer l’écosystème de l’information et à remporter la guerre de l’information. La troisième consiste à recourir à la répression sélective de manière à rendre très difficile pour les mouvements d’exploiter les moments d’intense brutalité. Et la quatrième consiste à perfectionner l’art de diviser pour mieux régner”. Pour que l’armée ou la police ne fasse pas défection, les autorités ont amélioré la formation des forces de sécurité. La corruption et le financement permet de s’attacher des soutiens plus indéfectibles. Les forces de sécurité sont également plus fragmentées, afin qu’une défection de l’une d’entre elles, n’implique pas les autres. Enfin, il s’agit également de faire varier la répression pour qu’une unité de sécurité ne devienne pas une cible de mouvements populaires par rapport aux autres. Les purges et les répressions des personnes déloyales ou suspectes sont devenues plus continues et violentes. “L’ensemble de ces techniques a rendu plus difficile pour les mouvements civiques de provoquer la défection des forces de sécurité, et cette tendance s’est accentuée au fil du temps”.
La seconde adaptation clé a consisté à gagner la guerre de l’information, notamment en dominant les écosystèmes de l’information. “Inonder la zone de rumeurs, de désinformation et de propagande, dont certaines peuvent être créées et testées par différents outils d’IA, en fait partie. Il en va de même pour la coupure d’Internet aux moments opportuns, puis sa réouverture au moment opportun”.
Le troisième volet de la panoplie consiste à appliquer une répression sélective, consistant à viser des individus plutôt que les mouvements pour des crimes graves qui peuvent sembler décorrélé des manifestations, en les accusant de terrorisme ou de préparation de coup d’Etat. ”La guerre juridique est un autre outil administratif clé”.
Le quatrième volet consiste à diviser pour mieux régner. En encourageant la mobilisation loyaliste, en induisant des divisions dans les mouvements, en les infiltrant pour les radicaliser, en les poussant à des actions violentes pour générer des reflux d’opinion…
Comment utiliser l’IA pour gagner ?
Dans la montée de l’adaptation des techniques pour défaire leurs opposants, la technologie joue un rôle, estime Erica Chenoweth. Jusqu’à présent, les mouvements civiques ont plutôt eu tendance à s’approprier et à utiliser, souvent de manière très innovantes, les technologies à leur avantage, par exemple à l’heure de l’arrivée d’internet, qui a très tôt été utilisé pour s’organiser et se mobiliser. Or, aujourd’hui, les mouvements civiques sont bien plus prudents et sceptiques à utiliser l’IA, contrairement aux régimes autocratiques. Pourtant, l’un des principaux problèmes des mouvements civiques consiste à “cerner leur environnement opérationnel”, c’est-à-dire de savoir qui est connecté à qui, qui les soutient ou pourrait les soutenir, sous quelles conditions ? Où sont les vulnérabilités du mouvement ? Réfléchir de manière créative à ces questions et enjeux, aux tactiques à déployer pourrait pourtant être un atout majeur pour que les mouvements démocratiques réussissent.
Les mouvements démocratiques passent bien plus de temps à sensibiliser et communiquer qu’à faire de la stratégie, rappelle la chercheuse. Et c’est là deux enjeux où les IA pourraient aider, estime-t-elle. En 2018 par exemple, lors des élections municipales russe, un algorithme a permis de contrôler les images de vidéosurveillance des bureaux de vote pour détecter des irrégularités permettant de dégager les séquences où des bulletins préremplis avaient été introduits dans les urnes. Ce qui aurait demandé un contrôle militant épuisant a pu être accompli très simplement. Autre exemple avec les applications BuyCat, BoyCott ou NoThanks, qui sont des applications de boycott de produits, permettant aux gens de participer très facilement à des actions (des applications puissantes, mais parfois peu transparentes sur leurs méthodes, expliquait Le Monde). Pour Chenoweth, les techniques qui fonctionnent doivent être mieux documentées et partagées pour qu’elles puissent servir à d’autres. Certains groupes proposent d’ailleurs déjà des formations sur l’utilisation de l’IA pour l’action militante, comme c’est le cas de Canvas, de Social Movement Technologies et du Cooperative Impact Lab.
Le Non Violent Action Lab a d’ailleurs publié un rapport sur le sujet : Comment l’IA peut-elle venir aider les mouvements démocratiques ? Pour Chenoweth, il est urgent d’évaluer si les outils d’IA facilitent ou compliquent réellement le succès des mouvements démocratiques. Encore faudrait-il que les mouvements démocratiques puissent accéder à des outils d’IA qui ne partagent pas leurs données avec des plateformes et avec les autorités. L’autre enjeu consiste à construire des corpus adaptés pour aider les mouvements à résister. Les corpus de l’IA s’appuient sur des données des 125 dernières années, alors que l’on sait déjà que ce qui fonctionnait il y a 60 ans ne fonctionne plus nécessairement.
Pourtant, estime Chenoweth, les mouvements populaires ont besoin d’outils pour démêler des processus délibératifs souvent complexes, et l’IA devrait pouvoir les y aider. “Aussi imparfait qu’ait été notre projet démocratique, nous le regretterons certainement lorsqu’il prendra fin”, conclut la politologue. En invitant les mouvements civiques à poser la question de l’utilisation de l’IA a leur profit, plutôt que de la rejetter d’emblée comme l’instrument de l’autoritarisme, elle invite à faire un pas de côté pour trouver des modalités pour refaire gagner les luttes sociales.
On lui suggérera tout de même de regarder du côté des projets que Audrey Tang mène à Taïwan avec le Collective intelligence for collective progress, comme ses « assemblées d’alignement » qui mobilise l’IA pour garantir une participation équitable et une écoute active de toutes les opinions. Comme Tang le défend dans son manifeste, Plurality, l’IA pourrait être une technologie d’extension du débat démocratique pour mieux organiser la complexité. Tang parle d’ailleurs de broad listening (« écoute élargie ») pour l’opposer au broadcasting, la diffusion de un vers tous. Une méthode mobilisée par un jeune ingénieur au poste de gouverneur de Tokyo, Takahiro Anno, qui a bénéficié d’une audience surprenante, sans néanmoins l’emporter. Son adversaire a depuis mobilisé la méthode pour lancer une consultation, Tokyo 2050.
Des pistes à observer certes, pour autant qu’on puisse mesurer vraiment leurs effets. Peuvent-elles permettent aux luttes sociales de l’emporter, comme le propose Chenoweth ? Le risque est fort de nous faire glisser vers une vie civique automatisée. Ajouter de l’IA ne signifie pas que les décisions demain seront plus justes, plus efficaces ou plus démocratiques. Au contraire. Le risque est fort que cet ajout bénéfice d’abord aux plus nantis au détriment de la diversité. L’enjeu demeure non pas d’ajouter des outils pour eux-mêmes, mais de savoir si ces outils produisent du changement et au profit de qui !