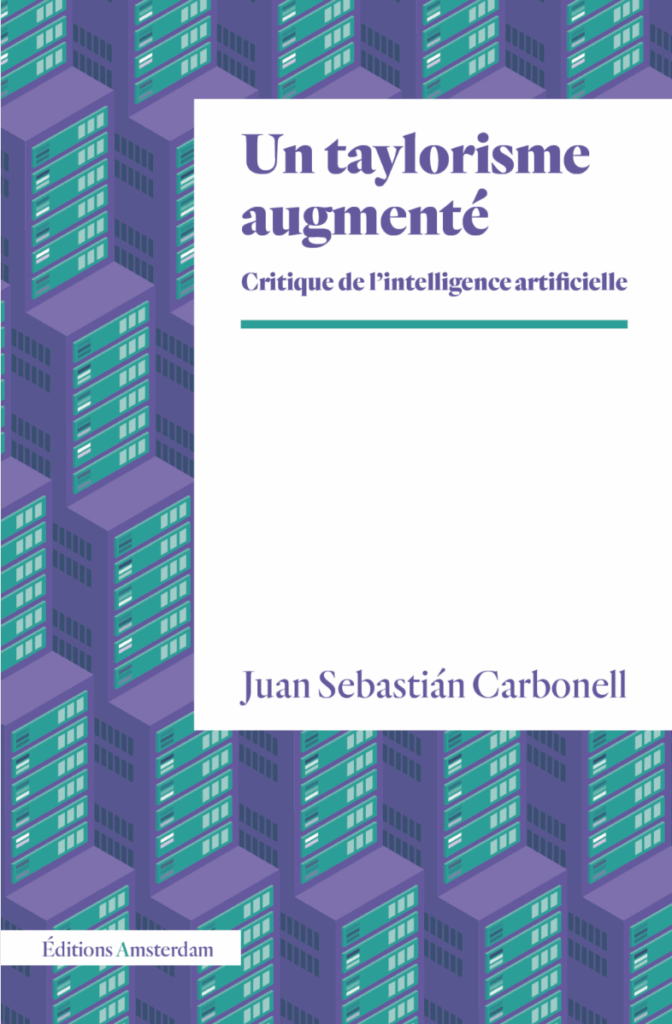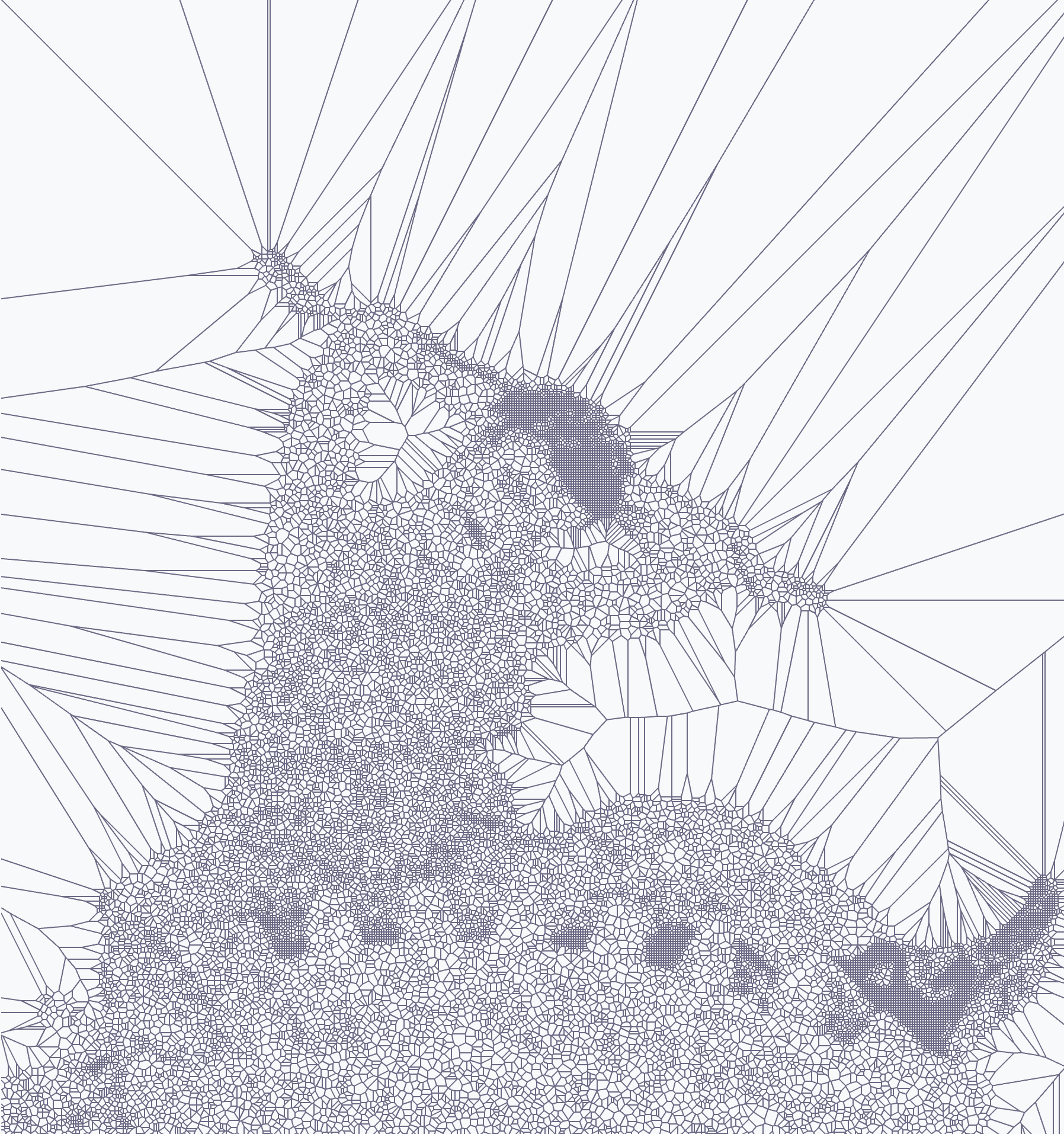Dans la même rubrique
Derrière le déploiement de l’IA dans les entreprises, une bataille des places est en cours. Dans le New York Times, le journaliste Noam Scheiber avait posé la question : « quels salariés vont être pénalisés par l’IA, les plus inexpérimentés ou les plus expérimentés ? » Sa conclusion montrait que c’était peut-être les travailleurs intermédiaires qui seraient les plus menacés. En réalité, pour l’instant, « l’alarme sur la destruction de l’emploi liée à l’IA n’a pas lieu d’être », expliquait Ekkehard Ernst, qui dirige l’observatoire sur l’IA et le travail dans l’économie numérique de l’OIT, qui rappelait combien le chômage technologique a toujours été rare. Cela n’empêche pas les inquiétudes d’être au plus haut, d’abord et avant tout, disions-nous, parce que la discussion sur le partage des fruits du déploiement de l’IA n’a pas lieu.
Dans son précédent livre, Le Futur du travail (éditions Amsterdam, 2022), le sociologue Juan Sebastian Carbonell nous expliquait déjà que le futur du travail n’était pas notre « grand remplacement » par les machines, mais notre prolétarisation. Il y décrivait déjà une « taylorisation assistée par ordinateurs » qui vise bien plus à « intensifier le travail, déqualifier les salariés, les discipliner et les surveiller ». Les robots ne travaillent pas à notre place mais nous imposent une intensification nouvelle, à l’image des employés de la logistique soumis aux rythmes de la commande vocale.
Un taylorisme sous stéroïdes…
Son nouveau livre, Un taylorisme augmenté : critique de l’intelligence artificielle (éditions Amsterdam, 2025) nous explique que l’IA n’est « ni une solution miracle aux problèmes de la société, ni Prométhée déchaîné », elle n’est qu’un taylorisme augmenté qui élude les questions de fonds que sont les conditions de travail, son organisation et la distribution du pouvoir. Le chercheur rappelle qu’il n’y a pas de consensus quant aux effets de l’IA sur le travail. Pour les uns, elle augmente les besoins de qualifications de ceux qui vont les utiliser, pour les autres, l’IA produit surtout une polarisation des emplois. Pour Carbonell, l’IA n’est ni l’un ni l’autre. Elle est d’abord un outil de dégradation du travail.
Pour le chercheur, il n’y a pas de polarisation homogène des emplois, c’est-à-dire le fait que les métiers intermédiaires et routiniers auraient tendance à disparaître au profit de métiers très qualifiés d’un côté et des métiers peu qualifiés et non routiniers de l’autre. Si ce phénomène s’observe parfois, les profils des emplois changent surtout au sein de mêmes métiers. Cela signifie qu’il faut non seulement prendre en compte les tâches, mais également l’organisation du travail. La distinction entre tâches routinières et non routinières est souvent caricaturée dans un discours qui dit que l’IA ferait disparaître les tâches répétitives pour nous en libérer. Ce n’est pas ce que constatent les employés de la logistique ou de la traduction, au contraire. Ce n’est plus ce que constatent également les codeurs, victimes désormais de la « Prompt fatigue », épuisés par l’usage de l’IA générative, rapporte Le Monde informatique… Certains qualifiant déjà le recours à ces outils « d’illusion de rapidité ».
« Le degré de routine ne fait pas tout », rappelle le sociologue. Il est nécessaire de prendre en compte, les « stratégies de profit » des entreprises et leur volonté à automatiser le travail. Enfin, la variété des produits, des composants et processus déterminent également la possibilité d’automatiser ou pas une production. « Une même technologie peut donc avoir des effets très différents sur le travail ». Des métiers hautement qualifiés, peu routiniers et hautement cognitifs peuvent ainsi être déstabilisés par l’IA, comme s’en inquiétait l’artiste Aurélie Crop sur son compte Instagram, en observant les possibilités du nouveau service d’IA de Google, Nano Banana, ou encore les scénaristes de cinéma associés face aux annonces d’OpenAI de produire un film d’animation entièrement génératif. Ces métiers ne vont pas disparaître, mais vont être taylorisés, c’est-à-dire « simplifiés, standardisés ou parcellisés ». C’est-à-dire précarisés pour en réduire le coût et augmenter les profits. Car ce qui demeure déterminant dans le choix technologique au travail, c’est le contrôle, « c’est-à-dire le pouvoir de décider comment on travaille et avec quels outils ».
… non pas guidé par l’efficacité technique mais par la prise de contrôle du management
Carbonell revient bien sûr sur l’émergence du taylorisme à la fin du XIXe siècle, rappelant combien il est lié à la vague d’immigration américaine, à l’entrée à l’usine d’ouvriers sans qualification, venant remplacer le long apprentissage des ouvriers spécialisés. L’objectif premier de Taylor était de « briser l’ouvrier de métier » pour y imposer la norme patronale c’est-à-dire contrôler le rythme et la façon de travailler. Le taylorisme a souvent été réduit à la chaîne de montage que Taylor n’a pourtant pas connu. Pour l’économiste Harry Braverman, le taylorisme consiste à dissocier le processus de travail en le décomposant, à séparer la conception de l’exécution et enfin à utiliser le monopole de l’organisation du travail pour contrôler chaque étape du processus et de son exécution. Parcelliser chaque métier abaisse le coût de chaque tâche, expliquait l’économiste américain. Ce taylorisme-là n’est pas mort avec Taylor, explique Carbonell, il se confond désormais avec l’organisation du travail elle-même. L’informatique, le numérique, puis l’IA aujourd’hui, sont surtout venus le renforcer.
Les machines rythment et contrôlent les décisions venues de la direction afin d’améliorer la productivité du travail. L’introduction des machines-outils à commande numérique après la Seconde Guerre mondiale va permettre de transférer les compétences des ouvriers à la direction en pilotant toujours plus finement et en standardisant l’usinage. Mais leur adoption ne repose pas sur le seul critère de l’efficacité technique, rappelle le sociologue, elle est d’abord le résultat de choix politiques, « notamment la volonté de retirer le contrôle du processus de travail aux tourneurs-fraiseurs ». « Une technologie s’impose surtout en raison de la supériorité des acteurs qui la promeuvent ». Pour Juan Sebastian Carbonell, le progrès technique ne s’impose pas de lui-même, sous couvert d’une efficacité immanente, mais répond d’abord d’enjeux politiques au profit de ceux qui le déploient. Le taylorisme augmenté n’a cessé de s’imposer depuis, par exemple avec les centres d’appels, avec l’invention de systèmes capables de distribuer les appels, complétés de scripts et de procédures extrêmement standardisées et des modalités capables de surveiller les échanges. Et l’IA ne fait rien pour arranger cela, au contraire. Ils sont désormais confrontés à « la tornade de l’intelligence artificielle », rappelait Alternatives Economiques, plongeant les services clients à un stade d’embolie terminal (voir notre article sur le sujet).
Le service client a ainsi pu être externalisé et les statuts des personnels dégradés. La standardisation et l’intensification vont toujours de pair, rappelle le sociologue. « Les tâches non automatisées par les outils ne sont pas celles qui ont un contenu peu routinier, mais plutôt celles qui, tout en étant routinières, sont trop coûteuses pour être automatisées ». A l’image de la logistique : on n’a pas remplacé les employés par des robots, mais on a transformé les employés en robots devant suivre les ordres des machine, comme l’expliquait très bien le sociologue David Gaborieau : « On n’est pas du tout en train d’automatiser les entrepôts, au contraire. Il y a de plus en plus d’ouvriers dans le secteur de la logistique. En fait, ce discours sur l’automatisation produit seulement des effets politiques et des effets d’invisibilisation du travail. On ne cesse de répéter que ces emplois vont disparaître ce qui permet surtout de les dévaluer. »
Si le taylorisme numérique est particulièrement frappant sur les plateformes, il s’applique également aux métiers très qualifiés, comme les musiciens, les artistes, les journalistes ou les traducteurs, à mesure qu’ils sont intégrés à des chaînes de valeur mondiales. Carbonell donne d’autres exemples de capture des connaissances et de confiscation des savoir-faire. Notamment avec les premiers systèmes experts d’IA symbolique, comme les systèmes pour diagnostiquer les maladies infectieuses ou gérer les protocoles de chimiothérapie ou encore les outil-test de maintenance de la RATP, mais qui, pour beaucoup, a surtout consisté à valider les protocoles organisés par ces logiciels qui proposaient surtout beaucoup d’alertes, nécessitant de passer du temps pour distinguer les alertes graves de celles qui ne le sont pas. Tous ces développements contribuent à « une déqualification des métiers, même les plus qualifiés ». L’IA connexionniste d’aujourd’hui, elle, est capable de faire fi des règles explicites pour formuler ses propres règles. La capture de connaissance devient un processus implicite, lié aux données disponibles. L’IA générative qui en est le prolongement, dépend très fortement du travail humain : d’abord du travail gratuit de ceux qui ont produit les données d’entraînement des modèles, celui des salariés et d’une multitude de micro-travailleurs qui viennent nettoyer, vérifier, annoter et corriger. Pour Carbonell, l’IA générative s’inscrit donc dans cette longue histoire de la « dépossession machinique ». « Elle n’est pas au service des travailleurs et ne les libère pas des tâches monotones et peu intéressantes ; ce sont les travailleurs qui sont mis à son service ». Dans le journalisme, comme le montrait un rapport d’Associated Press, l’usage de l’IA accroît la charge de travail et les dépossède du geste créatif : la rédaction d’articles. Ils doivent de plus en plus éditer les contenus générés par IA, comme de corriger les systèmes transformant les articles en posts de réseaux sociaux. Même constat dans le domaine de la traduction, où les traducteurs doivent de plus en plus corriger des contenus générés. Dans un cas comme dans l’autre, cependant, le développement de l’IA relève d’abord des choix économiques, sociaux, politiques et éditoriaux des entreprises.
Carbonell rappelle qu’il faut aussi saisir les limites technologiques et nuancer leurs performances. La qualité de la traduction automatique par exemple reste assez pauvre comme le constatent et le dénoncent les syndicats et collectifs de traducteurs, la Société française des traducteurs ou le collectif en Chair et en Os. En musclant leurs revendications (rémunération, transparence, signalement des traductions automatisées, fin des aides publiques à ceux qui ont recours à l’automatisation…), ils montrent que le changement technologique n’est pas une fatalité. C’est l’absence de critique radicale qui le rend inéluctable, défend Juan Sebastian Carbonell. Et le sociologue de battre en brèche l’inéluctabilité de l’IA ou le discours qui répète qu’il faut s’adapter pour survivre et se former. La formation ne remet pas en cause le pouvoir et l’organisation du travail. Elle ne reconnaît pas le droit des salariés à décider comment travailler. La formation ne propose rien d’autre que l’acceptation. Elle tient bien plus du catéchisme, comme le pointait pertinemment Ambroise Garel dans la newsletter du Pavé numérique.
La division du travail est un moyen pour rendre le management indispensable
Dans l’entreprise, le contrôle relève de plus en plus du seul monopole de l’employeur sur l’organisation du travail et sert à obtenir des salariés certains comportements, gestes et attitudes. Le contrôle a longtemps été l’apanage du contremaître, qui devint l’agent de la direction. A ce contrôle direct s’est ajouté un contrôle technique propre aux milieux industriels où les employés doivent répondre de la formulation des tâches avec des machines qui dirigent le processus de travail et imposent leur rythme. Après la Seconde Guerre mondiale s’ajoute encore un contrôle bureaucratique où la norme et les dispositifs de gestion remplacent le pouvoir personnel du contremaître. Le management algorithmique s’inscrit dans la continuité du commandement à distance et des dispositifs de gestion qui renforcent le taylorisme numérique. L’IA n’est qu’un outil de contrôle de plus, comme l’expliquaient Aiha Nguyen et Alexandra Mateescu de Data & Society.
Face à ces constats, le sociologue rappelle une question de fond : pourquoi le travail est-il divisé entre ceux qui commandent et ceux qui exécutent ? Pour l’économiste Stephen Marglin, la division du travail entre commandement et exécution n’est pas liée à l’efficacité économique ou technologique, mais serait purement politique, expliquait-il en 1974. « La division du travail et l’entreprise hiérarchisée ne résultent pas de la recherche d’une organisation du travail plus efficace, ni d’un progrès technologique, mais de la volonté des employeurs de se rendre indispensables en s’interposant entre le travailleur et le marché ». Le système de la fabrique comme le taylorisme visent à faire disparaître le contrôle ouvrier sur le travail au profit d’un contrôle managérial qui renforce la subordination. « C’est en approfondissant la division du travail que le capitaliste peut s’assurer de demeurer indispensable dans le processus de production, comme unificateur d’opérations séparées et comme accès au marché ». Contrairement à la vulgate, « les algorithmes ne sont pas des outils numériques permettant une coordination plus efficace », explique Carbonell, mais « des dispositifs de mise au travail traversés par des rapports de pouvoir ». La plateforme agit sur le marché, à l’image des algorithmes d’Uber. « En se plaçant entre le travailleur et le marché, il agit comme un employeur cherchant à exercer un contrôle numérique sur sa main d’œuvre ». Le management algorithmique produit et renforce le commandement. Il dirige, évalue et discipline et ces trois fonctions se renforcent l’une l’autre. Dans le cas des applications de livraisons de repas, ils interviennent à chaque étape, de la commande à la livraison en exploitant à chaque étape l’asymétrie de l’information qu’ils permettent et mettent en œuvre. Même chose avec les applications qui équipent les employés de la logistique ou ceux de la réparation, contrôlés en continue, les laissant avec de moins en moins de marge de manœuvre. Dans la restauration ou le commerce, le management algorithmique est d’abord utilisé pour pallier au très fort turnover des employés, comme le disait Madison Van Oort. L’évaluation y est permanente, que ce soit depuis les clients qui notent les travailleurs ou depuis les calculs de productivité qui comparent la productivité des travailleurs les uns avec les autres. Les systèmes disciplinent les travailleurs, comme l’expliquait la sociologue Karen Levy ou le chercheur Wolfie Christl. Elle produit les cadences. Licenciements, récompenses, promotions et pénalités sont désormais alignés aux performances. L’évaluation sert à produire les comportements attendus, comme le montrait Sophie Bernard dans UberUsés : le capitalisme racial de plateforme (Puf, 2023).
Mais il n’y a pas que les employés du bas de l’échelle qui sont ubérisés par ces contrôles automatisés, rappelle Carbonell. Les managers eux-mêmes sont désormais les exécutants de ce que leur disent les données. « Ils ne gèrent pas les travailleurs, ils appliquent ce que le système informatique leur dicte ». Et Carbonell de conclure en rappelant que notre patron n’est pas un algorithme. Dans le taylorisme augmenté, « l’asymétrie d’information devient une asymétrie de pouvoir ». L’asymétrie de l’information est le produit de la division du travail et celle-ci s’accentue avec des outils qui permettent d’atomiser le collectif et de mettre en concurrence les employés entre eux en les évaluant les uns par rapport aux autres.
Cette asymétrie n’est pas accidentelle, au contraire. Elle permet d’empêcher les collectifs de travail de contester les décisions prises. Sans droit de regard sur les données collectées et sur les modalités d’organisation des calculs, sans possibilité de réappropriation et donc sans discussion sur l’accès aux données des entreprises par les collectifs, rien n’évoluera. Comme le rappelle Carbonell, en Allemagne, l’introduction de nouvelles technologies qui surveillent la performance des travailleurs doit être validée par les comités d’entreprise où siègent les représentants du personnel. En France aussi, la négociation collective s’est timidement emparée du sujet. Le Centre d’études de l’emploi et du travail avait d’ailleurs livré une analyse des accords d’entreprise français signés entre 2017 et 2024 qui mentionnent l’IA. Depuis 2017, un peu moins d’un accord sur mille fait référence à l’IA, ceux-ci insistent particulièrement sur la préservation de l’emploi.
L’IA, moteur de déresponsabilisation
Pour l’instant, explique Juan Sebastian Carbonell, l’IA est surtout un moteur de déresponsabilisation des patrons. Les entreprises ont recours à des systèmes tiers pour établir ces surveillances et contrôles. Ce qui permet une forme de dispersion de la responsabilité, comme l’évoquait le professeur de droit d’Oxford, Jeremias Adams-Prassl, tout en « concentrant le contrôle » (voir également son livre, L’ubérisation du travail, Dalloz, 2021).
« De la même façon que, dans les configurations de l’emploi précaire, avec leurs schémas de sous-traitance en cascade, il est difficile d’établir qui est l’employeur responsable, l’usage d’IA dans la gestion de la main-d’œuvre brouille les frontières de la responsabilité », rappelle le sociologue. « Si les systèmes de contrôle (direct, technique, bureaucratique et algorithmique) se succèdent, c’est parce qu’ils rencontrent toujours des limites, correspondant aux résistances des travailleurs et de leurs organisations ». Pourtant, à mesure que le panoptique se referme, les résistances deviennent de plus en plus difficiles, faute de marge de manœuvre.
Pour Carbonell, un renouveau luddite aurait toute sa place aujourd’hui, pour donner aux individus et aux collectifs les moyens de garder un contrôle sur l’organisation du travail, pour réouvrir des marges de manœuvre. Reste que le « luddisme diffus » qui émerge à l’égard de l’IA ne s’incarne pas dans un mouvement de masse ancré dans les mondes du travail, mais au mieux « dans un rejet individuel et une approche morale de l’IA », voire dans une vision technique et éthique qui consiste à améliorer les calculs plus qu’à les rendre redevables. Les travailleurs ont pourtant de bonnes raisons de s’opposer au changement technologique au travail, conclut le sociologue, surtout quand il ne vient plus accompagné de progrès sociaux mais au contraire de leurs délitements, comme une solution de remplacement bon marché de l’Etat Providence, disaient la linguiste Emily Bender et la sociologue Alex Hanna dans leur récent livre, The AI Con (HarperCollins, 2025). Avec l’IA et l’ubérisation s’impose un monde où les statuts protecteurs du travail reculent.
L’appropriation collective des moyens de production n’est plus une promesse pour transformer le monde. Il ne peut y avoir de chaîne de montage socialiste, car « il n’y a rien de potentiellement émancipateur dans la dissociation entre la conception et l’exécution ». Peut-on imaginer une IA qui nous aide à sortir de Taylor plutôt que de nous y enfermer ?, questionne le sociologue en conclusion. Une IA qui rende du pouvoir aux travailleurs, qui leur permette de concevoir et d’exécuter, qui leur rende du métier plutôt qu’elle ne les en dépossède.
Pour l’instant, on ne l’a pas encore aperçu !
Hubert Guillaud