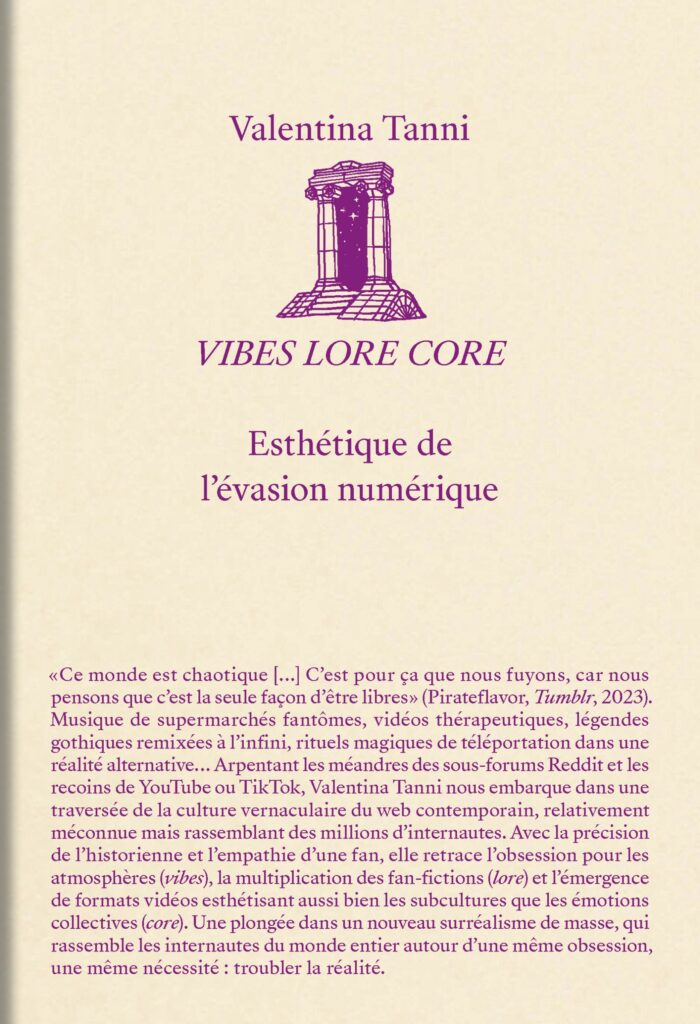Dans la même rubrique
« Il y a eu un moment où finir internet semblait presque un objectif atteignable ».
L’historienne de l’art italienne et curatrice, Valentina Tanni signe Vibes Lore Core : esthétique de l’évasion numérique (Audimat édition, 2025), traduction d’un essai paru en anglais en 2023, sous le titre Exit Reality, et nous offre une plongée très documentée dans le « fourmillement du monde » d’internet et plus particulièrement dans les productions culturelles et esthétiques natives du réseau.
Si les systèmes de recommandation ont eu tendance à homogénéiser la culture en réseau, les sous-cultures y ont également explosé, rappelait-elle dans une interview pour Le Monde. Et ce sont elles sur lesquelles l’historienne pose son regard. Les esthétiques collaboratives nées sur internet ne sont pas à la périphérie de l’art contemporain, mais en son centre, défend-t-elle. « Elles constituent les symptômes les plus fiables du climat culturel qui nous entoure car elles naissent d’une élaboration collective impliquant des millions de personnes ». Son enquête sur des phénomènes créatifs, massifs et insaisissables à la fois, intriqués les uns aux autres, toujours mutants, est une réflexion assez puissante sur ce qu’internet nous fait, sur ce que notre consultation de cet outre-monde produit en chacun de nous. A savoir, un trouble, une dissonance, liée à l’écart entre la réalité et cette autre réalité que nous habitons également.
Dans cette exploration des expressions artistiques les plus étranges de la culture web, allant des mèmes les plus weird à l’ASMR, en passant par la passion pour les espaces liminaux ou les fans-fictions artistiques… Derrière ces esthétiques abandonnées et toujours renouvelées, derrière ces sons que personne ne semble avoir produit, ces images qui se répètent et se transforment, Valentina Tanni explore une forme de surréalisme de masse et derrière lui, le trouble de la réalité qu’internet produit sur chacun d’entre nous. Autant de phénomènes qui témoignent de la perception altérée du monde numérique par ceux qui l’habitent, de sa pesante étrangeté. Le réseau n’est pas seulement le support de ces phénomènes culturels, mais est également « ce qui nourrit ces cultures et les rend possibles ». Ces subcultures d’apparences superficielles semblent des réponses ironiques à l’hypercapitalisme que produit notre connexion au web, une forme de surréalisme de l’ère numérique, une forme d’expression inconsciente d’une mémoire collective en train de se construire et de se dissoudre à la fois. Entre des souvenirs d’un futur qui n’a pas eu lieu et la nostalgie de futurs passés toujours recomposés. Internet est devenu la porte de notre rapport au monde, dans lequel chacun projette les ruines de la réalité dans un internet qui incarne l’avenir depuis bien trop longtemps. Dans les sous-cultures du web, l’optimisme semble avoir été mis au rebut, expliquait l’artiste Svetlana Boym dans The Future of Nostalgia (2001) : « L’espace idéal de la nostalgie n’est pas la mémoire, mais l’imagination ». Les souvenirs, fragmentaires et instables que nous partageons, sont le point de départ d’une ré-élaboration créative et continue. « Dans l’imaginaire vaporwave, la basse résolution, le glitch et l’interférence » sont les composantes d’un travail sur la mémoire qui se délite à son tour, comme derrière la fragilité de la techno, dans l’archéologie du réseau lui-même, se superposent des couches de mémorisation, les unes sur les autres, qu’il suffirait de mettre à jour. Les productions fantasmatiques des utilisateurs cherchent à exploiter l’état hypnagogique, entre la veille et le sommeil, un territoire liminal, aux marges de la conscience. Dans les esthétiques du réseau, tout tourne autour de « réalités altérées » où irréalité, surréalité, déréalisation sont la norme. Les esthétiques auxquelles s’intéresse Tanni finissent par n’être que des humeurs, des atmosphères, des vibrations, des sensations… comme si l’essence de tout ce qu’on partage via le réseau des réseaux n’avait pas d’autres impacts qu’émotionnels. Piégés dans un gigantesque centre commercial entourés de formes infinies de divertissement, ce que la culture internet produit semble au final n’être qu’une simulation sensorielle. Comme si, en fin de compte, notre immersion dans internet infusait en chacun d’entre nous un même état d’esprit, une même vision du monde, un même épuisement. Comme si les expressions esthétiques produites par le réseau ne menaient qu’aux mêmes désillusions, d’une nostalgie l’autre. Comme si ce monde dans lequel on s’immerge ne finissait par produire qu’une nostalgie de l’avoir toujours laissé passé. On pense aux fils sans fin des réseaux sociaux, à leurs évolutions, à leurs répétitions, même si les formes expressives évoluent. Comme si des premiers mèmes aux flux de vidéos sous IA, quelque chose se répétait inlassablement… dans l’épuisement qu’il produit sur chacun d’entre nous.
Un internet des sensations
Pour Valentina Tanni, ces expressions culturelles sont d’abord un moyen de produire des sensations, des émotions. Ce sont elles qui parcourent les réseaux et nous marquent. A l’image de l’AMSR, qui vise à produire en chacun d’entre nous des frissons. L’acronyme inventé en 2010 par Jennifer Allen signifie Autonomous Sensory Meridian Response (Réponse autonome du méridien sensoriel). Mais derrière son semblant de nom savant, il ne décrit rien d’autre qu’une pratique totalement empirique où les sons chuchotés sont censés déclencher un plaisir sensoriel, stimulant, relaxant. Né encore une fois comme un phénomène de niche, l’ASMR est devenu un pilier de la culture internet. Mais plus qu’un plaisir sensoriel, l’ASMR crée d’abord une sensation d’intimité, de chaleur humaine, de coprésence physique dans un monde qui en est dépourvu. Là encore, la culture ASMR naît et se développe entièrement sur internet. Apparu en 2007, c’est dix ans plus tard qu’elle apparaît dans la communication commerciale des marques, marquant sa généralisation, comme l’explique la chercheuse Joanna Lapinska, qui voit dans le phénomène l’expression de l’importance accrue accordée au corps et aux sensations dans la culture occidentale, « éléments clés de l’expérience individuelle de la réalité ». Même constat pour l’artiste et curatrice Ariane Koek dans son essai « Ouf of our Minds », pour le catalogue de l’exposition Real Feelings : emotion and technology (CMV, 2020) : « Les sentiments et non les faits sont la nouvelle vérité ». Les sensations restent incontestables. Et face à la dépression d’un monde qui s’effondre tout autour de nous, l’enjeu risque d’être bien plus de les intensifier que le contraire. Tout comme les ASMR sont des impulsions à recevoir, la technologie devient un moyen pour la stimulation. L’écosystème informationnel ne génère pas une plus grande connaissance du monde extérieur, au contraire, elle déclenche un mouvement vertigineux vers l’intériorité. « Si le monde devient inconnaissable, la réalité chaque jour plus instable et la vérité une utopie à abandonner, la seule voie praticable est celle de l’auto-exploration », explique Valentina Tanni. Nombre des mèmes culturels qui parcourent le réseau sont autant d’instruments pour stimuler ses sensations dans un monde anesthésié par les écrans. L’immersion sensorielle devient le levier pour agir sur ses émotions. Tout est bon pour créer des formes d’hyperstimulation, des phénomènes de flow, comme disait Mihaly Csikszentmihalyi.
Sur l’internet, disait Kenneth Goldsmith dans Wasting time on the internet (Harper, 2016, non traduit), nous sommes plongés dans un nouvel inconscient collectif. La distraction est devenu notre état permanent. Le réseau nous transporte vers un nouveau soi, « amplifié, augmenté, hypersensible ». La vibe, l’humeur, l’énergie… sont les mots d’ordre de la contre-culture. Comme le pointait Erik Davis, dans son livre Techgnosis : Myth, Magic, & Mysticism in the Age of Information (1998) notre rapport à la technologie a toujours été imprégné de pensée magique. Ces « vibrations », humeurs et énergies se diffusent de manière mémétique. Elles résonnent dans les mailles du réseau. Et plus le stimulus de départ est fort, plus la résonance sera grande. L’enjeu n’est plus autre que de faire vibrer le réseau lui-même dans une même communion, à l’image de ces vidéos qui deviennent virales et que tout le monde copie, remixe, adapte. « Les vibes glissent les unes sur les autres. L’énergie est en constante mutation ».
Valentina Tanni n’a pas son pareil pour pointer vers ces mèmes qu’elle dissèque. Elle évoque par exemple les Backrooms, les pièces de derrière et avec elles, les histoires étranges qui percent sur l’internet, comme celles que racontait Nicolas Nova dans Persistance du merveilleux. Les Slender Men comme les Backrooms par exemple se répandent sur l’internet d’un forum l’autre. « La narration ouverte et modifiable permet à chacun de contribuer » pour faire vivre les histoires qui parcourent le réseau. Les légendes d’internet, son folklore qui se déverse et s’abreuve de ses propres dynamiques, se nourrisent des anomalies et des bugs du réseau pour produire du sens sur ce qui n’en a pas toujours. Ces jeux de réalités se jouent de nous. La réalité contiendrait des trous, comme notre conscience qui se déconnecte dans le flow. Pour Tanni, ces « narrations infestantes », ce folklore, ce lore, exploite les sous-cultures et contre-cultures, les reconstruit, les agence, tente d’en produire des narrations cohérentes… Le lore est un modèle de connaissance permettant d’interfacer la réalité et la fiction, de structurer la fiction comme si elle était réelle, rappelaient ceux qui se sont penchés sur le phénomène. En retour, ces univers interrogent la réalité, ce que nous appelons la réalité qui est « aujourd’hui la fantaisie créée par les médias de masse ». « L’expansion narrative des utilisateurs est un mécanisme infestant qui s’attache à n’importe quelle histoire et la transforme en un système ramifié en expansion continue, désordonnée ». Et que l’on retrouve des fans fictions aux délires paranormaux ou complotistes comme les recense par exemple la Fondation SCP. Les troubles dans la toile alimentent les fictions qui alimentent en retour les troubles, à l’image des espaces liminaux, ces lieux entre les lieux, abandonnés, vides, à l’image de ceux mis en avant dans la série Severance. Ces espaces à la fois familiers et dépeuplés, comme des souvenirs en ruines. A l’image de bureaux vides voire hyper-vides, qui semblent étranges, pareils à des déserts artificiels. La liminalité est le moment exact où nous sommes sur le point de devenir, mais ne le sommes pas encore, une forme de limbe entre l’adolescence et la vie adulte, entre la veille et le rêve, rappelle Tanni. Un espace intermédiaire propice à être occupé : une suspension. A l’image des mondes virtuels, générés aléatoirement, qui ne sont pas faits pour être habités, mais que nous parcourons sans fin dans les jeux vidéo.Tout cela fait écho à la peur de l’infini, au monde comme illusion. « L’imaginaire liminal tourne autour de sentiments contradictoires : attraction et répulsion, familiarité et étrangeté, confort et terreur ». Une forme de nostalgie incarnée : leur caractère vide ressemble à nos souvenirs dans lesquels nous ne pourrons plus jamais retourner, comme si l’on pouvait retourner dans un passé, désormais inhabité. Les espaces liminaux sont les memento mori d’aujourd’hui, ceux qui nous rappellent l’irréversibilité du temps.
Internet est façonné par les rêves, les traumatismes, les cauchemars de chacun qui se déclinent en d’innombrables esthétiques weirdcore, dreamcore, traumacore… (« dans les esthétiques qui se terminent en -core, le suffixe signifie que le mot principal est le thème de l’esthétique »). Ces esthétiques sont la prolongation des espaces liminaux, leur appropriation. Les espaces qui n’existent pas ou plus évoquent la sortie de la dimension réelle (comme le mode noclipping du jeu vidéo). « Le weirdcore est une représentation visuelle des sensations de dépersonnalisation et de déréalisation », entre la réalité et l’altérité. Comme si une altération de la réalité permettait d’entrapercevoir son autre face, comme un état de dissociation. Comme un écho de notre consommation excessive d’écrans nous débranche également de la réalité, brouille nos sens, déforme la perception. Ces espaces et pratiques, ces mèmes sont des exutoires, où les traumas côtoient des éléments inoffensifs, kawaï, qui représentent l’innocence ou les illusions perdues. Ces propositions esthétiques semblent assez proches de ce que décrivait la sociologue Dominique Pasquier dans son livre, L’internet des familles modestes (Presses des mines, 2018) en évoquant les citations que les gens partagent sur Facebook, comme des petites figures de morale populaires qui se propagent en chaîne. Ici, ce sont des figures esthétiques, des angoisses, des espoirs, des mèmes parmi d’autres qui eux aussi se propagent en chaînes, externalisant et aseptisant les sentiments qu’ils portent. Les figures esthétiques sont autant de templates, de hastags qui facilitent le processus d’appropriation, de copie, d’inspiration, de remix. Les éléments esthétiques partagés créent communauté et « jettent les bases d’une élaboration collective du trauma », jusqu’à leur leur simplification voire leur sublimation, dans des postures morbides et cute à la fois.
Pour Valentina Tanni, l’accès à l’ordinateur nous a traumatisé. « Internet n’est pas seulement un lieu où exorciser des peurs, des troubles, des frustrations. Il est aussi, à son tour, une source potentielle de trauma. C’est un grand réservoir où des générations entières d’être humains continuent de déverser des idées, des sentiments, des émotions, des instincts et des désirs ». David Bowie dans une interview datant de 1999 le disait très bien : internet,« c’est une forme de vie extraterrestre ». Une esthétique du chaos, réaction à la perfection marketing du réseau et seul moyen de rendre compte du chaos d’un cerveau constamment en ligne, comme disait Rebecca Jennings. Les œuvres esthétiques d’internet, les mèmes, sont le résultat d’une forme de « catharsis collective », une forme de communion face à l’apocalypse qui s’annonce. Même constat pour Geert Lovink dans Extinction Internet qui rappelle que les mèmes célèbrent souvent l’effondrement, une rupture que la culture internet « transmet, incarne et reproduit ». Ce que propose le réseau n’est-il pas de passer de la réalité actuelle à la réalité désirée, entre le sommeil et l’éveil, la conscience et l’inconscience ? Où sommes-nous vraiment quand nous sommes sur le réseau ?, interroge Tanni. Dans un rêve lucide sans fin ? Dans une forme de tulpamancie comme le disait déjà l’immense Rémi Sussan ? Internet est-il le moyen de s’évader de la réalité ou de la rejoindre ?
Le réseau semble démultiplier les leviers pour rejoindre une réalité qui n’est plus ni stable ni permanente, « une réalité que nous avons de plus en plus de mal à distinguer de la fiction, qui naît souvent déjà fictionnelle, et qui nous apparaît chaque jour plus incontrôlable ».
Internet est rempli de contenus qui ironisent sur la nature de la réalité (comme les créations hyperréalistes de la pâtissière turque Tuba Geçkil) bien avant l’apparition du slop et de l’IA générative qui semblent être venu accélérer cette tendance. Comme si le réseau nous ramenait toujours à chercher le sens de ce que nous voyons : qu’est-ce que la réalité ? qu’est-ce que l’existence ? Quel est le sens de l’existence ? « Dans les expressions culturelles en ligne, le concept de réalité est continuellement remis en question ».
Quelle est la réalité de ce qu’internet produit en nous ?
Valentina Tanni nous rappelle que « les utilisateurs d’internet ont continuellement affaire au problème de l’interprétation de ce qu’ils voient, entendent et lisent. Ils sont submergés par des contenus d’origine diversifiée et souvent inconnue ; chaque message reçu doit être attentivement évalué et confronté à l’ensemble des connaissances déjà possédées, en soi déjà instable et sujet aux fluctuations imprévues de la mémoire et des humeurs. Les outils pour s’orienter à l’intérieur de l’océan informationnel, chaque jour plus obscur et tumultueux, sont peu nombreux et fonctionnent de moins en moins. » Le concept de réalité n’a jamais été simple et stable. Nous avons longtemps cru qu’il suffisait d’accumuler des documents pour avoir des preuves d’existence, pour certifier la réalité. « Maintenant, nous nous apercevons que c’est la quantité même des preuves qui enraye le regard, le trouble, le rend inutilisable ». Conçus pour mettre de l’ordre au monde, les ordinateurs finalement nous ont conduit à la complexité et au chaos. Même le concept de post-vérité apparaît désormais réducteur et dépassé. Le vrai et le faux ne seront plus jamais distinguables. La multiplication des points de vue fragilise la réalité même. Chaque histoire produit des versions infinies, et toutes sont accessibles via une page web. Et ces histoires s’annoncent plus nombreuses encore demain avec une IA générative prête à les démultiplier. Entre les bots, les contenus génératifs, le spam… nous naviguons plus que jamais dans un internet mort, zombie, où nous tentons de percevoir des signes de vie. Selon les partisans de la dead internet theory, hypothèse conspirationniste, l’internet des être humains serait déjà mort depuis 2016. L’activité des bots occuperait d’ailleurs déjà 64% du trafic internet. Le monde réel, la nature, deviennent l’antidote au détachement systématique de notre environnement que produit notre connexion continue au réseau. (go outside and touch grass). Dans le documentaire de la réalisatrice Hayley Garrigus, You can’t kill meme (2021), les virus mentaux nous contaminent via des pratiques rituelles que l’internet permet. « Une méfiance croissante envers le système, alliée à la sensation d’une perte intégrale du contrôle sur le destin du monde servent de bouillon de culture pour l’émergence de mécanismes alternatifs d’interprétation de la réalité ». « Le réseau reste une porte toujours prête à être franchie ». Un grand organisme dont nous sommes les cellules. Prêts à dériver comme disait Debord. En 2009, l’artiste américain Justin Kemp, avec son projet Adding to the internet montrait qu’il n’y avait pas tout sur l’internet, en proposant de créer des images quand Google images ne produisait pas de résultats, produisant du slop avant l’heure. « Les produits culturels imaginaires » que produisent les IA génératives vont accélérer l’influence des choses qui n’existent pas.
« Un demi-siècle d’hypersaturation médiatique, et au moins une vingtaine d’années de culture participative en ligne, ont conduit à la naissance d’une société entièrement centrée sur la création et l’échange de contenus. Produire et consommer des médias est le rituel clé du monde contemporain, en plus d’être son jeu collectif préféré ». Et l’IA ouvre encore plus ces possibilités, jusqu’à la perte totale du contrôle.
Sur le réseau, nous sommes toujours au seuil d’une autre réalité
L’écran est un seuil. Une porte, vers des espaces qui n’existent que lorsque les machines fonctionnent, conclut Tanni. Sur le réseau, nous sommes nulle part. Ni ici, ni là. La vie sur écran est férocement hallucinatoire. « Le PC est le LSD des années 90 » déclarait déjà Timothy Leary en 1994. La connexion à internet a l’apparence d’un voyage extracorporel, comme quand on participe à une visioconférence. Marc Augé le disait déjà en évoquant les non-lieux : « La télévision et l’ordinateur occupent maintenant l’espace de l’ancien foyer ». Nous habitons une dimension intermédiaire désormais, quitte à délaisser le monde réel, comme l’évoquent les battlestations, les images de nos écrans, des lieux d’où nous nous connectons au monde, qui ne sont pas toutes propres et lissent, mais parfois délabrées. Ces cabines de pilotage, ces capsules de téléportation, ces espaces d’emprisonnement, ressemblent bien plus souvent à des ruines qu’autre chose, montrant combien nos esprits ont basculé en ligne au détriment du monde. « La technologie nous a placés dans un endroit étrange, où nous ne sommes jamais totalement présents ». Un endroit incorporel. Une caverne, entre celle de Platon et la panopticon de Jeremy Bentham, dont il n’est pas sûr que nous puissions sortir, pris dans les rets des entreprises de la Tech, « otages des plateformes », coincés dans une forme d’auto-stimulation sans fin, un flux constant de spectacles. Pour l’artiste et théoricien Vladan Joler dans New Extractivism (2020), notre grotte, notre cellule, est un lieu de plaisir d’où le prisonnier n’a pas même la volonté de sortir. Nous observons un spectacle, des mêmes, des archétypes, à l’image de la plus célèbre photo du monde, celle qui a été le fond d’écran de Windows, prise par Charles O’Rear. Un logo sous forme de paysage, une scène hyperréelle, « une représentation parfaite d’un lieu intérieur, d’un paysage de la conscience ». Nos ordinateurs et nos smartphones sont colonisés par les images (boutons, icônes…) qui nous semblent invisibles et qui pourtant pénètrent notre inconscient et dont les esthétiques influencent notre imaginaire bien plus que nous le pensons. N’avons-nous pas passé plus de temps dans les décors de jeux vidéo que dans les espaces où nous avons séjourné ? Les images se transforment en lieu. C’est là que nous habitons. Oui, c’est là. Tout au fond du réseau. Et Valentina Tanni nous rappelle combien cet espace nous transforme, sans que nous sachions très bien comment.
Hubert Guillaud